En s'appuyant sur le Référentiel des compétences langagières pour enseigner le/en français au Sénégal, les activités proposées dans ce livret ciblent les objectifs ci-dessous en compréhension écrite.
Objectif général : Comprendre dans le détail des textes longs et complexes qu'ils se rapportent ou non à son domaine professionnel ou ses centres d'intérêt, en modulant si nécessaire sa vitesse de lecture.
Démarche : Compréhension écrite. En route vers C1 +⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 01_CE1_demarche.pdf
Objectifs d'apprentissage⚓
En s'appuyant sur le Référentiel des compétences langagières pour enseigner le/en français au Sénégal, les activités proposées dans ce livret ciblent les objectifs ci-dessous en compréhension écrite.
Objectif général : Comprendre dans le détail des textes longs et complexes qu'ils se rapportent ou non à son domaine professionnel ou ses centres d'intérêt, en modulant si nécessaire sa vitesse de lecture.
Objectifs d'apprentissage :
Comprendre des textes longs et complexes en s'appuyant sur les informations explicites et implicites.
Comprendre un ensemble de documents traitant d'un thème relatif à sa spécialité ou non et effectuer une synthèse des informations.
Comprendre les particularités stylistiques les plus évidentes d'un texte littéraire.
Reconnaître le contexte social, politique, historique ou scientifique d'un document.
Comprendre dans le détail des textes informatifs, même sans rapport avec des sujets familiers.
Donner son point de vue, apprécier un texte en mobilisant ses connaissances littéraires ou personnelles dans le domaine.
Comprendre les messages implicites d'expressions, de jeux de mots et en apprécier les effets (ex : ironie, humour, etc.)
Effectuer une synthèse d'informations tirées de la lecture de différents graphiques, schémas, illustrations.
Apprécier un texte, de manière argumentée, en mobilisant ses connaissances culturelles.
Chacune des fiches de compréhension écrite se termine par une activité visant la maîtrise des structures de la langue, afin de faire un rappel sur les points suivants :
L'ordre des termes dans la phrase
La pro nominalisation
L'emploi des pronoms sujet et complément
La subordination : cause/conséquence/but
Le complément d'objet indirect
Le complément d'agent
Le complément circonstanciel de cause
La voix active - La voix passive
La cause
Les pronoms relatifs
Les connecteurs logiques
L'expression des circonstances
Les mots de liaison
La focalisation
Le discours rapporté
La stylistique : l'anaphore
La ponctuation
Conjugaison : l'emploi des pronoms
L'accord du verbe
L'imparfait
Vocabulaire : le sens des mots et des expressions
Les familles de mots
Les suffixes et préfixes
La synonymie et l'antonymie
Le champ sémantique
Le champ lexical
Les expressions d'origine latine
L'ellipse
Le discours rapporté
Le discours indirect libre : le point de vue
Les registres de langue
L'orthographe lexicale
- Homonymes : tout, tous, etc. ; plus tôt, plutôt ;
Les temps et les modes: le conditionnel
L'accord du participe passé
Le conditionnel présent/passé
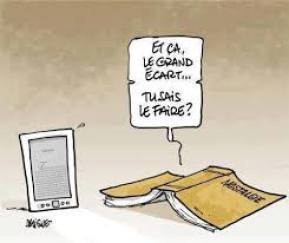
Introduction⚓
La formation initiale des élèves-enseignants du cycle fondamental comporte un module d'amélioration des compétences langagières en français afin que tous les enseignants, à la sortie de la formation, soient au niveau B2 du référentiel des compétences langagières pour enseigner le/en français au Sénégal , voire au niveau C1/C2 dès que cela est possible.
Ce module est régulé par des tests de positionnement (Test National pour Enseigner le/en Français : T.N.E.F), qui permettent à chaque élève-enseignant de connaître son niveau dans les 3 activités langagières que sont : la compréhension orale (CO), la compréhension écrite (CE), la maîtrise des structures de la langue (MSL).
Le degré de maîtrise en français se repère sur une échelle globale graduée en 4 niveaux : Infra B1 (A1-A2), B1, B2, C1 et + (C1-C2).
Infra B1 (A1 et A2) Utilisateur élémentaire | B1-B2 Utilisateur intermédiaire | C1 + (C1 et C2) Utilisateur expérimenté |
A1- Élémentaire Maîtrise de base du français. La personne est capable de comprendre des situations simples et concrètes se rapportant à la vie quotidienne. Elle peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement. | B1- Niveau Seuil Maîtrise efficace mais limitée de la langue. La personne comprend un langage clair et standard s'il s'agit d'un domaine familier. Elle peut se débrouiller en voyage, parler de ses centres d'intérêt et donner de brèves explications sur un projet ou une idée. | C1 - Supérieur Bonne maîtrise de la langue. La personne peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants comportant des contenus implicites. Elle s'exprime couramment de façon bien structurée sur sa vie sociale, professionnelle ou académique et sur des sujets complexes. |
A2- Élémentaire avancé Maîtrise élémentaire de la langue. La personne peut comprendre des phrases isolées portant sur des domaines familiers. Elle peut communiquer dans des situations courantes et évoquer avec des moyens simples des questions qui la concernent. | B2 - Intermédiaire avancé Maîtrise générale et spontanée de la langue. La personne peut comprendre l'essentiel d'un texte complexe. Elle peut participer à une conversation sur un sujet général ou professionnel de façon claire et détaillée en donnant des avis argumentés. | C2 - Supérieur avancé Excellente maîtrise de la langue. La personne comprend sans effort pratiquement tout ce qu'elle lit ou entend et peut tout résumer de façon cohérente. Elle s'exprime très couramment et de façon différenciée et nuancée sur des sujets complexes. |
Au regard des résultats qu'il obtient, l'élève-enseignant identifie s'il est nécessaire de conforter certains domaines et sélectionne les supports d'auto-formation appropriés à ses besoins. Il choisit des livrets correspondant au degré supérieur des scores qu'il a obtenus « en route vers B1 », « en route vers B2 », « en route vers C1+ ».
A noter que la maîtrise des structures de la langue est une activité transversale, dans tous les livrets.
Pendant les cours en présentiel, le formateur de français assure le suivi des activités réalisées en auto-formation et propose pour les compléter des activités favorisant l'expression orale et l'expression écrite.
Grille d'auto-évaluation en compréhension écrite⚓
A compléter plusieurs fois pour mesurer vos progrès. A chaque fois que vous faites le point, indiquez votre auto-estimation : 1. Acquis – 2. En cours d'acquisition – 3. A renforcer. Repérez vos faiblesses et fixez-vous des objectifs d'apprentissage prioritaires.
Activités langagières | Dates |
1. Compréhension écrite
| |
2. Production écrite
|
Examinez aussi l'évolution de vos scores en compréhension écrite avec le TNEF :
TNEF N°1 :................
TNEF N°2 : ..............
TNEF N°3 : ..............
Comment améliorer sa compréhension écrite ? Conseils⚓
Comprendre un texte, c'est construire progressivement une représentation mentale cohérente de ce que raconte le texte. Le lecteur doit combiner les informations explicites et implicites contenues dans le texte à ses propres connaissances personnelles sur le sujet. Cette représentation mentale du texte est dynamique : elle se transforme et se complexifie au cours de la lecture, au fur et à mesure de l'apport des informations.
On distingue différents niveaux de compréhension s'échelonnant de la compréhension de base à la compréhension fine d'un texte. La classification la plus partagée parle de compréhension littérale, compréhension inférentielle, compréhension critique.
- La compréhension littérale provient de l'information donnée précisément par le texte.
- La compréhension inférentielle demande à faire des liens entre les différentes parties du texte, ou entre le texte et ses connaissances personnelles. Ces liens ne sont pas fournis explicitement par le texte.
- La compréhension critique du texte permet au lecteur d'apprécier le texte, d'évaluer sa pertinence en fonction de ses propres connaissances du monde.
Les stratégies de compréhension en lecture sont des outils qui peuvent servir à faciliter la compréhension d'un texte. Par exemple :
1. Avant la lecture |
etc. |
2. Pendant la lecture |
etc. |
3. Après la lecture |
etc |
Arrêter sa lecture et faire des retours en arrière. Relire la partie difficile que l'on n'a pas comprise, en la relisant à mi-voix si besoin. Si l'on se sert de la relecture comme stratégie, ne pas relire tout le texte mais seulement la partie incomprise.
Continuer à lire, puis revenir en arrière. En effet, parfois relire ne permet pas de résoudre le problème. L'auteur n'a peut-être pas donné assez d'informations. Il faut continuer sa lecture pour trouver des informations complémentaires puis revenir en arrière pour voir si le problème est résolu.
Repenser au but de sa lecture. Quand le texte est long, on peut perdre son objectif de lecture. En cours de lecture, il peut être utile de s'arrêter pour faire le point. Doit-on trouver des informations particulières ? Répondre à une question précise ?
Se redire ce qu'on vient de lire. Il peut être utile de faire des arrêts au cours d'une lecture longue afin de reformuler ce que l'on vient de lire, et donc de faire des résumés intermédiaires dans ses propres mots.
Se faire des images mentales. Quand on perd pied dans sa lecture, il est bon de s'essayer de faire dans sa tête « le film » de ce qui vient d'être lu.
Se poser des questions au fur et à mesure de la lecture : Pourquoi ? Comment ? Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?
Émettre des hypothèses sur la suite du texte et les infirmer ou les confirmer en lisant la suite.
Examiner les graphiques, les illustrations, les schémas. Souvent, les textes informatifs contiennent des informations graphiques qui permettent de mieux comprendre le texte.
Recourir au dictionnaire. Ce qui permet de rechercher le sens des mots que l'on ne comprend pas.
Comprendre un texte, c'est construire progressivement une représentation mentale cohérente de ce que raconte le texte. Le lecteur doit combiner les informations explicites et implicites contenues dans le texte à ses propres connaissances personnelles sur le sujet. Cette représentation mentale du texte est dynamique : elle se transforme et se complexifie au cours de la lecture, au fur et à mesure de l'apport des informations.
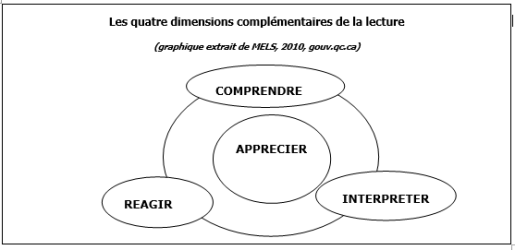
Comprendre : c'est un processus qui permet de donner du sens au texte lu, à partir des informations explicites et implicites (inférences) apportées par l'auteur. La compréhension d'un texte s'effectue dans le respect du texte ou des propos de l'auteur, ce qui lui donne un caractère « objectif ».
Réagir : c'est un processus qui renvoie aux effets que le texte produit sur le lecteur et qui comporte un caractère « subjectif ». Cela permet d'exprimer et d'expliciter des émotions, des sentiments suscités par le texte.
Interpréter: c'est un processus qui renvoie aux diverses significations que l'on peut prêter à un texte, sans le contredire. L'interprétation s'appuie sur des données objectives du texte et sur les connaissances personnelles du lecteur.
Apprécier : c'est la capacité à exprimer un jugement sur un texte à partir d'un ou de plusieurs critères. Cela implique une mise en relation du texte avec un ou plusieurs autres textes. Ce qui suppose un contact fréquent avec des œuvres nombreuses et variées.
La compréhension écrite dans ce livret s'exerce à partir de documents écrits d'intérêt général ou professionnel en recourant à différents types de texte (narratifs, injonctifs, explicatifs, informatifs, dialogués ou poétiques, etc.). Les exercices permettent d'exercer la compréhension littérale, la compréhension inférentielle (implicite) et de s'exercer à résumer les informations des textes proposés, et de les apprécier.
Vous travaillerez sur des textes longs (1500 à 3000 mots), excepté lorsque l'information est plus dense et spécialisée. Pour bien comprendre les documents écrits proposés, il peut être utile de :
Survoler rapidement le texte afin de voir si le thème vous est connu.
Lire en premier lieu le questionnaire auquel il vous faudra répondre. Cette lecture constitue « un filtre » à la lecture du texte, ce qui permettra de relever plus rapidement les informations nécessaires pour réaliser les exercices.
Observer le « para-texte » des supports proposés : illustrations, présence ou non de paragraphes, leur disposition, présence ou non d'un chapeau, d'un surtitre, repérage de chiffres, noms propres ou sigles, permettant d'avoir une première idée sur le contenu du texte.
Lire une première fois le texte et donner une première réponse (pendant ou après la lecture) aux exercices qui ne posent pas de difficulté.
Lire une deuxième fois le texte si besoin pour contrôler les premières réponses apportées et répondre aux autres exercices estimés plus difficiles.
Relire l'ensemble des réponses apportées aux exercices. Vérifiez qu'elles soient claires et ne prêtent pas au doute. Corrigez l'orthographe si besoin.
La démarche adoptée souhaite donc amener les lecteurs à développer des stratégies de compréhension en lecture. Par la suite, l'élève-enseignant pourra également appliquer ce type de démarche en classe avec ses élèves pour renforcer leurs compétences de lecture.
Réchauffement climatique⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 02_CE1_Rechauffement_climatique.pdf
Texte à lire
Réchauffement climatique
La température moyenne de notre planète résulte de l'équilibre entre le flux de rayonnement qui lui parvient du soleil et le flux de rayonnement infrarouge renvoyé vers l'espace. La répartition de la température au niveau du sol dépend de la quantité de gaz à effet de serre (GES) présents dans l'atmosphère. Sans eux, la température moyenne serait de -18°C et la terre serait inhabitable. Leur présence amène cette température à 15°C.
Certains gaz responsables de l'effet de serre sont d'origine anthropique. Les gaz à effet de serre sont naturellement très peu abondants. Mais du fait de l'activité humaine, la concentration de ces gaz dans l'atmosphère s'est sensiblement modifiée : ainsi, la concentration en C02, principal GES, a augmenté de 30% depuis l'ère préindustrielle. Les effets combinés de tous les GES équivalent aujourd'hui à une augmentation de 50% de CO2 depuis cette période.
Lorsque nous utilisons des énergies fossiles, telles que le charbon, le pétrole ou le gaz, nous brûlons du carbone, ajoutant ainsi du CO2 à l'air : environ 20 milliards de tonnes par an dans le monde. Les océans et les forêts et, dans une bien moindre mesure, les autres plantes, éliminent à peu près la moitié de cet excédent de gaz carbonique. Cependant, sa concentration ne cesse de croître : de l'ordre de 0,028 % il y a cent cinquante ans, elle est aujourd'hui de 0,036 %.
Un autre gaz à effet de serre est le méthane (CH4), dont la concentration a doublé depuis la révolution industrielle. Les sources "humaines" sont les rizières, les décharges d'ordures, les élevages bovins, les fuites sur les réseaux de gaz et l'exploitation charbonnière. L'oxyde nitreux, ou protoxyde d'azote (N2O) est un autre gaz à effet de serre, qui provient de certaines industries et des excès d'épandages d'engrais.
Les deux principaux gaz à effet de serre sont le gaz carbonique, qui contribue à l'effet de serre à une hauteur de 60 %, et le méthane. Cependant, tandis que le méthane n'a qu'une faible durée de vie dans l'atmosphère, le gaz carbonique y demeure pendant plus d'un siècle. C'est pourquoi l'attention se focalise aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz carbonique.
Les tendances à la désertification ont une incidence sur les réservoirs et les puits mondiaux de carbone. À ce titre, la désertification contribue au réchauffement de la planète. D'après les prévisions, une élévation de la température mondiale de 1 à 2 °C entre 2030 et 2050 se soldera par des changements climatiques dans les régions touchées par la désertification, entraînant donc davantage d'évaporation, une baisse de l'humidité des sols et une aggravation de la dégradation des terres au Moyen-Orient et dans les zones arides d'Asie, des sécheresses répétées en Afrique et une plus grande vulnérabilité des terres arides et semi-arides à la désertification. Ainsi, si les changements climatiques sont appelés à accentuer les processus de désertification aux niveaux régional et local, les causes et les conséquences de la désertification accentuent elles aussi, à leur tour, les changements climatiques à l'échelle de la planète, principalement par leur effet sur la végétation.
Source : Changement climatique / Réchauffement planétaire / L'effet de serre / Les Gaz à Effet de Serre (GES) : http://www.tarbes.fr/gp/C-comme/378/0
Compréhension écrite : activité 1
compréhension écrite : activité 2
Compréhension écrite : activité 3-a
Compréhension écrite : activité 3-b
Compréhension écrite : activité 3-c
Question⚓
A votre avis, en quoi les effets de la désertification sur la végétation interviennent sur le changement climatique ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 4
Question⚓
Relevez, dans le texte, tous les éléments qui contribuent à l'augmentation du CO2 dans l'air.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 5
Question⚓
Pourquoi l'attention se focalise-t-elle aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz carbonique ? Citez plusieurs raisons.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Outils de la langue : activité 6
Outils de la langue : activité 7
Question⚓
Mettez le passage ci-dessous au passé en remplaçant, dans la dernière phrase, "aujourd'hui" par "alors". Veillez à la concordance des temps.
"Les deux principaux gaz à effet de serre sont le gaz carbonique, qui contribue à l'effet de serre à une hauteur de 60 %, et le méthane. Cependant, tandis que le méthane n'a qu'une faible durée de vie dans l'atmosphère, le gaz carbonique y demeure pendant plus d'un siècle. C'est pourquoi l'attention se focalise aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz carbonique."
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Réchauffement climatique[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Solution⚓
Les deux principaux gaz à effet de serre étaient le gaz carbonique, qui contribuait à l'effet de serre à une hauteur de 60 %, et le méthane. Cependant, tandis que le méthane n'avait qu'une faible durée de vie dans l'atmosphère, le gaz carbonique y demeurait pendant plus d'un siècle. C'est pourquoi l'attention se focalisa alors sur la réduction des émissions de gaz carbonique.
Enfance malheureuse⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 03_CE1_Enfance_malheureuse.pdf
Pauvre petit garçon
Comme d'habitude, Mme Klara emmena son petit garçon, cinq ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ trois heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise (...)
On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient Laitue. (...)
Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin (...)
Pourtant quand les autres gamins passaient devant lui, Dolfi épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire : « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ? »
Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolfi. C'était un jouet de quatre sous mais il était flambant neuf et puis il était différent des leurs et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit : « Hé ! vous autres !... vous avez vu la Laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ? »
Un autre dit : « La Laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, son fusil, c'est de la camelote !
Mme Klara était assise sur un banc, occupée à tricoter. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle, il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. « Allons, Dolfi, va jouer, l'encourageait Mme Klara, sans lever les yeux de son travail.
- Jouer avec qui ?
- Mais avec les autres petits garçons, voyons ! vous êtes tous amis, non ?
- Non, on n'est pas amis, disait Dolfi. Quand je vais jouer ils se moquent de moi.
- Tu dis cela parce qu'ils t'appellent Laitue ?
- Je veux pas qu'ils m'appellent Laitue !
- Pourtant moi je trouve que c'est un joli nom.»
Mais lui, obstiné :
« Je veux pas qu'on m'appelle Laitue ! »
Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolfi avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt ils l'avaient appelé Laitue et s'étaient mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.
Mais cette fois lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabules les autres garçons s'approchèrent :
« Tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. Fais voir. »
Dolfi sans le lâcher laissa l'autre l'examiner.
« Pas mal », reconnut Max avec l'autorité d'un expert.
Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins vingt fois plus que le fusil. Dolfi en fut très flatté.
« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.
- Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine », dit un troisième.
Et Dolfi les regardait émerveillé. Ils ne l'avaient pas encore appelé Laitue. Il commença à s'enhardir.
Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là.
Pour la première fois, Dolfi se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité : il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois armés de fronde et ils l'expédièrent en tête de l'armée, avec l'ordre de sonder le passage : Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse. D'une façon presque excessive.
Alors Dolfi se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide.
« Hé ! capitaine Dolfi, pars immédiatement à l'attaque, les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais... »
Dolfi se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation.
« Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.
- Allons, capitaine, à l'attaque ! intima le général.
Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolfi qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.
« A l'attaque, les enfants ! » cria t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.
Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup il sentit son pied retenu. A dix centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle.
Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétrie avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes !
« Tiens! Attrape, capitaine Laitue. »
Enfin il sentit que les autres s'enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus servir à rien.
Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée.
« Mon Dieu! Dolfi, qu'est-ce que tu as fait ? »
Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère : quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans quinze, vingt ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie.
« Oh! le pauvre petit! » s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara.
Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolfi.
Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, humiliée, sans défense (...)
- « Allons, Dolfi, viens te changer ! » fit la mère en colère.
Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement plus laid, un rictus dur lui plissa la bouche.
« Oh ! ces enfants! quelles histoires ils font pour un rien ! s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. Au revoir, Madame Hitler! »
Dino BUZZATI, 1967, "Pauvre Petit garçon" dans Le K, Paris, Robert Laffont
Compréhension écrite : activité 1-a
Question⚓
Qui sont les deux principaux personnages de cette histoire ? Justifiez votre réponse.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 1-b
Question⚓
De quelle condition sociale sont-ils ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 1-b
Compréhension écrite : activité 2-a
Compréhension écrite : activité 2-b
Sélectionnez la phrase dans la description du personnage qui semble confirmer votre réponse.
Votre réponse :
Pauvre petit garçon
Comme d'habitude, Mme Klara emmena son petit garçon, cinq ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ trois heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise (...)
On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient Laitue. (...)
Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin (...)
Pourtant quand les autres gamins passaient devant lui, Dolfi épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire : « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ? »
Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolfi. C'était un jouet de quatre sous mais il était flambant neuf et puis il était différent des leurs et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit : « Hé ! vous autres !... vous avez vu la Laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ? »
Un autre dit : « La Laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, son fusil, c'est de la camelote !
Mme Klara était assise sur un banc, occupée à tricoter. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle, il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. « Allons, Dolfi, va jouer, l'encourageait Mme Klara, sans lever les yeux de son travail.
- Jouer avec qui ?
- Mais avec les autres petits garçons, voyons ! vous êtes tous amis, non ?
- Non, on n'est pas amis, disait Dolfi. Quand je vais jouer ils se moquent de moi.
- Tu dis cela parce qu'ils t'appellent Laitue ?
- Je veux pas qu'ils m'appellent Laitue !
- Pourtant moi je trouve que c'est un joli nom.»
Mais lui, obstiné :
« Je veux pas qu'on m'appelle Laitue ! »
Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolfi avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt ils l'avaient appelé Laitue et s'étaient mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.
Mais cette fois lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabules les autres garçons s'approchèrent :
« Tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. Fais voir. »
Dolfi sans le lâcher laissa l'autre l'examiner.
« Pas mal », reconnut Max avec l'autorité d'un expert.
Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins vingt fois plus que le fusil. Dolfi en fut très flatté.
« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.
- Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine », dit un troisième.
Et Dolfi les regardait émerveillé. Ils ne l'avaient pas encore appelé Laitue. Il commença à s'enhardir.
Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là.
Pour la première fois, Dolfi se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité : il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois armés de fronde et ils l'expédièrent en tête de l'armée, avec l'ordre de sonder le passage : Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse. D'une façon presque excessive.
Alors Dolfi se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide.
« Hé ! capitaine Dolfi, pars immédiatement à l'attaque, les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais... »
Dolfi se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation.
« Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.
- Allons, capitaine, à l'attaque ! intima le général.
Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolfi qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.
« A l'attaque, les enfants ! » cria t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.
Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup il sentit son pied retenu. A dix centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle.
Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétrie avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes !
« Tiens! Attrape, capitaine Laitue. »
Enfin il sentit que les autres s'enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus servir à rien.
Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée.
« Mon Dieu! Dolfi, qu'est-ce que tu as fait ? »
Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère : quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans quinze, vingt ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie.
« Oh! le pauvre petit! » s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara.
Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolfi.
Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, humiliée, sans défense (...)
- « Allons, Dolfi, viens te changer ! » fit la mère en colère.
Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement plus laid, un rictus dur lui plissa la bouche.
« Oh ! ces enfants! quelles histoires ils font pour un rien ! s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. Au revoir, Madame Hitler! »
Dino BUZZATI, 1967, "Pauvre Petit garçon" dans Le K, Paris, Robert Laffont
Réponse attendue :
Pauvre petit garçon
Comme d'habitude, Mme Klara emmena son petit garçon, cinq ans, au jardin public, au bord du fleuve. Il était environ trois heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise (...)
On ne pouvait pas dire non plus de cet enfant qu'il était beau, au contraire, il était plutôt pitoyable même, maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert, au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient Laitue. (...)
Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf qui tirait même de petites cartouches, inoffensives bien sûr. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants car d'ordinaire ils le tracassaient, alors il préférait rester tout seul dans son coin (...)
Pourtant quand les autres gamins passaient devant lui, Dolfi épaulait son fusil et faisait semblant de tirer, mais sans animosité, c'était plutôt une invitation, comme s'il avait voulu leur dire : « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de jouer avec vous ? »
Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolfi. C'était un jouet de quatre sous mais il était flambant neuf et puis il était différent des leurs et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. L'un d'eux dit : « Hé ! vous autres !... vous avez vu la Laitue, le fusil qu'il a aujourd'hui ? »
Un autre dit : « La Laitue a apporté son fusil seulement pour nous le faire voir et nous faire bisquer mais il ne jouera pas avec nous. D'ailleurs, son fusil, c'est de la camelote !
Mme Klara était assise sur un banc, occupée à tricoter. Son petit garçon était assis, bêtement désœuvré, à côté d'elle, il n'osait pas se risquer dans l'allée avec son fusil et il le manipulait avec maladresse. « Allons, Dolfi, va jouer, l'encourageait Mme Klara, sans lever les yeux de son travail.
- Jouer avec qui ?
- Mais avec les autres petits garçons, voyons ! vous êtes tous amis, non ?
- Non, on n'est pas amis, disait Dolfi. Quand je vais jouer ils se moquent de moi.
- Tu dis cela parce qu'ils t'appellent Laitue ?
- Je veux pas qu'ils m'appellent Laitue !
- Pourtant moi je trouve que c'est un joli nom.»
Mais lui, obstiné :
« Je veux pas qu'on m'appelle Laitue ! »
Les autres enfants jouaient habituellement à la guerre et ce jour-là aussi. Dolfi avait tenté une fois de se joindre à eux, mais aussitôt ils l'avaient appelé Laitue et s'étaient mis à rire. Ils étaient presque tous blonds, lui au contraire était brun, avec une petite mèche qui lui retombait sur le front en virgule. Les autres avaient de bonnes grosses jambes, lui au contraire avait de vraies flûtes maigres et grêles. Les autres couraient et sautaient comme des lapins, lui, avec sa meilleure volonté, ne réussissait pas à les suivre. Ils avaient des fusils, des sabres, des frondes, des arcs, des sarbacanes, des casques. Le fils de l'ingénieur Weiss avait même une cuirasse brillante comme celle des hussards. Les autres, qui avaient pourtant le même âge que lui, connaissaient une quantité de gros mots très énergiques et il n'osait pas les répéter. Ils étaient forts et lui si faible.
Mais cette fois lui aussi était venu avec un fusil. C'est alors qu'après avoir tenu conciliabules les autres garçons s'approchèrent :
« Tu as un beau fusil, dit Max, le fils de l'ingénieur Weiss. Fais voir. »
Dolfi sans le lâcher laissa l'autre l'examiner.
« Pas mal », reconnut Max avec l'autorité d'un expert.
Il portait en bandoulière une carabine à air comprimé qui coûtait au moins vingt fois plus que le fusil. Dolfi en fut très flatté.
« Avec ce fusil, toi aussi tu peux faire la guerre, dit Walter en baissant les paupières avec condescendance.
- Mais oui, avec ce fusil, tu peux être capitaine », dit un troisième.
Et Dolfi les regardait émerveillé. Ils ne l'avaient pas encore appelé Laitue. Il commença à s'enhardir.
Alors ils lui expliquèrent comment ils allaient faire la guerre ce jour-là.
Pour la première fois, Dolfi se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Walter lui confia une mission de grande responsabilité : il commanderait l'avant-garde. Ils lui donnèrent comme escorte deux bambins à l'air sournois armés de fronde et ils l'expédièrent en tête de l'armée, avec l'ordre de sonder le passage : Walter et les autres lui souriaient avec gentillesse. D'une façon presque excessive.
Alors Dolfi se dirigea vers la petite allée qui descendait en pente rapide.
« Hé ! capitaine Dolfi, pars immédiatement à l'attaque, les autres n'ont sûrement pas encore eu le temps d'arriver, ordonna Walter sur un ton confidentiel. Aussitôt que tu es arrivé en bas, nous accourons et nous y soutenons leur assaut. Mais toi, cours, cours le plus vite que tu peux, on ne sait jamais... »
Dolfi se retourna pour le regarder. Il remarqua que tant Walter que ses autres compagnons d'armes avaient un étrange sourire. Il eut un instant d'hésitation.
« Qu'est-ce qu'il y a ? demanda-t-il.
- Allons, capitaine, à l'attaque ! intima le général.
Au même moment, de l'autre côté du fleuve invisible, passa une fanfare militaire. Les palpitations émouvantes de la trompette pénétrèrent comme un flot de vie dans le cœur de Dolfi qui serra fièrement son ridicule petit fusil et se sentit appelé par la gloire.
« A l'attaque, les enfants ! » cria t-il, comme il n'aurait jamais eu le courage de le faire dans des conditions normales.
Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup il sentit son pied retenu. A dix centimètres du sol, ils avaient tendu une ficelle.
Il s'étala de tout son long par terre, se cognant douloureusement le nez. Le fusil lui échappa des mains. Un tumulte de cris et de coups se mêla aux échos ardents de la fanfare. Il essaya de se relever mais les ennemis débouchèrent des buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétrie avec de l'eau. Un de ces projectiles le frappa en plein sur l'oreille le faisant trébucher de nouveau. Alors ils sautèrent tous sur lui et le piétinèrent. Même Walter, son général, même ses compagnons d'armes !
« Tiens! Attrape, capitaine Laitue. »
Enfin il sentit que les autres s'enfuyaient, le son héroïque de la fanfare s'estompait au-delà du fleuve. Secoué par des sanglots désespérés il chercha tout autour de lui son fusil. Il le ramassa. Ce n'était plus qu'un tronçon de métal tordu. Quelqu'un avait fait sauter le canon, il ne pouvait plus servir à rien.
Avec cette douloureuse relique à la main, saignant du nez, les genoux couronnés, couvert de terre de la tête aux pieds, il alla retrouver sa maman dans l'allée.
« Mon Dieu! Dolfi, qu'est-ce que tu as fait ? »
Elle ne lui demandait pas ce que les autres lui avaient fait mais ce qu'il avait fait, lui. Instinctif dépit de la brave ménagère qui voit un vêtement complètement perdu. Mais il y avait aussi l'humiliation de la mère : quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ? Elle essaya d'imaginer son fils dans quinze, vingt ans. Elle aurait aimé se le représenter en uniforme, à la tête d'un escadron de cavalerie, ou patron d'une belle boutique, ou officier de marine. Mais elle n'y arrivait pas. Elle le voyait toujours assis un porte-plume à la main, avec de grandes feuilles de papier devant lui, penché sur le banc de l'école, penché sur la table de la maison, penché sur le bureau d'une étude poussiéreuse. Un bureaucrate, un petit homme terne. Il serait toujours un pauvre diable, vaincu par la vie.
« Oh! le pauvre petit! » s'apitoya une jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara.
Et secouant la tête, elle caressa le visage défait de Dolfi.
Le garçon leva les yeux, reconnaissant, il essaya de sourire, et une sorte de lumière éclaira un bref instant son visage pâle. Il y avait toute l'amère solitude d'une créature fragile, humiliée, sans défense (...)
- « Allons, Dolfi, viens te changer ! » fit la mère en colère.
Alors le bambin se remit à sangloter à cœur fendre, son visage devint subitement plus laid, un rictus dur lui plissa la bouche.
« Oh ! ces enfants! quelles histoires ils font pour un rien ! s'exclama l'autre dame agacée en les quittant. Au revoir, Madame Hitler! »
Dino BUZZATI, 1967, "Pauvre Petit garçon" dans Le K, Paris, Robert Laffont
Compréhension écrite : activité 3
Compréhension écrite : activité 4
Question⚓
Relevez dans le texte un passage au style indirect libre (l'auteur fait parler un personnage à la 3e personne, sans utiliser de verbe introducteur ni guillemets) montrant que la mère est peu fière de son fils.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Solution⚓
...quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Quelle misérable destinée l'attendait ? Pourquoi n'avait-elle pas mis au monde, elle aussi, un de ces garçons blonds et robustes qui couraient dans le jardin ? Pourquoi Dolfi restait-il si rachitique ? Pourquoi était-il toujours si pâle? Pourquoi était-il si peu sympathique aux autres ? Pourquoi n'avait-il pas de sang dans les veines et se laissait-il toujours mener par les autres et conduire par le bout du nez ?
Compréhension écrite : activité 5
Question⚓
Relevez des indices du texte montrant que le narrateur ne présente pas Dolfi de manière neutre, objective.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enfance malheureuse[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 6-a
Compréhension écrite : activité 6-b
Question⚓
Le titre « Pauvre petit garçon » convient au texte si l'on se place du point de vue de la « jeune femme élégante qui parlait avec Mme Klara ».
Quel titre pourrait-on donner au texte si l'on se place du point de vue de :
La mère ?
Dolfi ?
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Outils de la langue : activité 7
Outils de la langue : activité 8
Le "fléau" du téléphone portable⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 04_CE1_Le_fleau_du_telephone_.pdf
Texte à lire
Le « fléau » du portable en classe touche aussi les enseignants
C'est un problème auquel sont désormais confrontés la plupart des enseignants du supérieur, mais aussi ceux du secondaire et même du primaire : durant les cours, l'usage quasi-systématique des téléphones portables par leurs élèves. Ceux-ci ne cessent d'échanger des messages (et des photos), de consulter leur appareil, de guetter l'arrivée de la réponse à leurs envois... Résultat, une baisse spectaculaire du niveau général de l'attention et de la concentration en classe. Avec des répercussions évidentes sur l'acquisition de connaissances et sur l'aptitude à comprendre les phénomènes, quelle que soit la discipline enseignée. Un grand nombre d'enseignants se plaignent de cette situation. Certains persistent à faire la guerre aux portables et à tenter de les interdire en classe ; beaucoup finissent par renoncer, tant la lutte leur paraît inégale, les élèves déployant des trésors d'imagination pour continuer à utiliser leur appareil en cachette, contre vents et marées.
Là où les choses prennent une tournure assez cocasse, c'est que les enseignants et pédagogues ne sont pas eux-mêmes épargnés par ce fléau qu'ils dénoncent. Il suffit pour s'en convaincre d'observer leur comportement lorsqu'ils participent à une réunion, conseil de classe ou d'établissement, colloque, conférence, réunion de travail, etc.
Pour ne prendre que cet exemple (mais on pourrait en trouver des milliers d'autres), l'auteur de ces lignes a ainsi pu assister il y a quelques jours à un séminaire organisé par la business school espagnole IE, l'une des plus cotées en Europe. Dans l'assistance, une centaine d'experts venus du monde entier : chercheurs en sciences de l'éducation, responsables d'agences dédiées à l'enseignement supérieur, professeurs, patrons d'universités ou de grandes écoles... Leur comportement était édifiant : en permanence, au moins un tiers d'entre eux utilisaient leur tablette, smartphone ou ordinateur pour des activités sans rapport avec l'objet du colloque : envoi de mails privés, consultation de sites d'information (voire de sites boursiers...), réservation de taxi ou d'avion, échange avec leurs collègues... A certains moments, les deux tiers de l'auditoire étaient ailleurs, quelque part dans le cyberespace numérique. Au fait, le thème du séminaire - au demeurant passionnant ? "Réinventer l'enseignement supérieur"... On ne saurait mieux dire.
Quels enseignements tirer de cette observation ? D'abord, que la "dépendance" à l'égard des objets numériques, qui façonne notre esprit et notre faculté d'attention, est loin d'être l'apanage des jeunes générations - de ceux qu'on appelle les "digital natives" : elle s'est répandue de façon foudroyante, et touche désormais ceux-là même qui la dénoncent, ou qui devraient logiquement s'en inquiéter.
Deuxième leçon : il n'est sans doute pas possible pour les enseignants de lutter de façon frontale contre un tel tsunami. Plutôt que de faire barrage, mieux vaut sans doute tenter d'en limiter les excès, mais aussi essayer d'utiliser ces outils numériques au bénéfice de l'enseignement. Le e-learning, les MOOC, les nouvelles formes d'enseignement montrent que c'est possible. Dans ce domaine, beaucoup reste sans doute à inventer. Pour autant, il convient de se garder de tout enthousiasme béat, et de conserver une certaine "distance critique". Certains acteurs, par exemple, ont l'impression d'avoir permis un grand bond en avant de l'apprentissage par le seul fait d'avoir mis entre les mains des jeunes une tablette ou un ordinateur... Or si le numérique peut apporter beaucoup à l'enseignement, les bénéfices que l'on peut en attendre ne sont peut-être pas toujours aussi importants ni aussi rapides qu'on le dit. En dépit de la pression intéressée des grands acteurs du numérique, une évaluation précise reste à faire en la matière.
Enfin, on peut imaginer que les enseignants tentent d'ouvrir un débat constructif en classe sur les bienfaits, mais aussi les pièges - risques sur la vie privée, par exemple - de l'usage des outils numériques. Sur ce point au moins, ils ne devraient pas avoir trop de mal à obtenir toute l'attention de leurs élèves.
PS : Notons au passage que quelques établissements s'intéressent aux changements induits par le numérique et sa toute-puissance. Citons par exemple le colloque organisé le 4 novembre prochain par l'université Toulouse 1-Capitole (Centre de droit des affaires et Irdeic) et consacré à Google et au droit à l'oubli numérique.
Stéphane Cassereau, directeur de l'IRT de Nantes, 25 octobre 2014, http://focuscampus.blog.lemonde.fr
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2-a
Compréhension écrite : activité 2-b
Question⚓
Trouvez un synonyme du mot fléau et employez-le dans une phrase.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 2-c
Question⚓
Retrouvez dans les paragraphes 4 et 5 des mots et expressions qui justifient le titre du texte : "Le "fléau" du téléphone portable.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 3-a
Question⚓
Dans le passage ci-dessous, dites quelles conséquences engendre l'usage du portable dans les relations enseignants/élèves.
« De plus en plus d'enseignants se plaignent de cette situation. Certains persistent à faire la guerre aux portables et à tenter de les interdire en classe ; beaucoup finissent par renoncer, tant la lutte leur paraît inégale, les élèves déployant des trésors d'imagination pour continuer à utiliser leur appareil en cachette, contre vents et marées. »
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 3-b
Compréhension écrite : activité 4
Question⚓
Trouvez et classez selon l'ordre de gravité les 3 autres mots par lesquels l'auteur désigne le "fléau".
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 5
Question⚓
Que pensez-vous de la progression utilisée dans la dénomination de ce phénomène ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 6
Question⚓
Lequel de ces 3 mots peut faire penser à la drogue ? Pourquoi ?
problème - dépendance - tsunami
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Le "fléau" du téléphone portable[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 7
Compréhension écrite : activité 8
Question⚓
Réécrivez le passage suivant en remplaçant le mot « cocasse » par son synonyme : comique, grave, dérangeant, surprenant
"Là où les choses prennent une tournure assez cocasse, c'est que les enseignants et pédagogues ne sont pas eux-mêmes épargnés par ce fléau qu'ils dénoncent."
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 9
Question⚓
Réécrivez le passage suivant en transformant la 2ème phrase en une subordonnée circonstancielle sans en changer le sens.
« Ceux-ci ne cessent d'échanger des messages (et des photos), de consulter leur appareil, de guetter l'arrivée de la réponse à leurs envois... Résultat, une baisse spectaculaire du niveau général de l'attention et de la concentration en classe. »
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Outils de la langue : activité 10-a
Outils de la langue : activité 10-b
Question⚓
Donnez le sens de "autant" dans les phrases suivantes :
a) S'il a fait cela, je peux en faire autant.
b) Autant d'hommes, autant d'avis.
c) Autant vous raconter tout de suite cette histoire pour éviter un malentendu.
d) Il a beaucoup travaillé, il n'a pas réussi pour autant.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Traditions et modernisme⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 05_CE1_Traditions_et_modernisme.pdf
Texte à lire
Après la visite d'Anta, mon père m'appela après le dîner.
- Malick, tu sais maintenant que tu es en âge de te marier ?
- En effet, père !
- En bien ! je pense que tu pourras faire un choix judicieux. Quoi qu'il en soit, pour ma part, je crois que celle que je te propose te conviendra et que nous pourrons nous entendre.
- Je ne comprends pas encore ce que tu veux dire, père !
- Que si, tu comprends très bien ! ou plutôt, oui ! tu ne comprends rien du tout. J'avais oublié que tu n'avais pas passé ton enfance dans le village et que certaines de nos coutumes te sont inconnues. C'est là le principal inconvénient avec vous autres, gens de la ville. Vous vous embourgeoisez trop vite et oubliez votre origine. Pour toi, c'est différent. C'est grâce à moi que tu es revenu au village pour y chercher du travail et tu peux voir que tu ne le regrettes pas.
- En effet, père ! répétai-je.
- Donc tu as renoué avec notre tradition et je t'en félicite... tu devais sans doute te demander pourquoi Anta est venue ici l'autre jour. C'est en accord avec sa famille et moi qu'elle l'a fait. Tu ne sais pas qu'en la raccompagnant chez elle et en y retournant le lendemain même y prendre le thé, tu t'imposais officiellement chez elle. Les choses étant ce qu'elles sont, vos deux familles ont décidé de vous marier jeudi prochain. La fille s'est déclarée enchantée de l'événement ; c'est toi maintenant que je dois convaincre.
Peut-être que si tu étais vraiment un étranger cela aurait pu paraître difficile et je l'aurais compris, mais tu es né dans ce village ; malheureusement, ta mère mourrait peu de temps après et je fus obligé de te confier à sa sœur. Alhamdoulilahi rabil halamina, tu as vécu, alors que tous pensaient le contraire. Tu as étudié et tu as eu ton baccalauréat. Après tu as quitté l'école. Depuis lors, je te suis et, je te l'ai déjà dit, je t'ai fait venir ici.
Comment ? Tu dois le deviner. Donc tu t'es imposé chez cette jeune fille et vous allez vous marier. Comment te convaincre ? D'ailleurs, « convaincre » est un terme approprié... tu sais que je jouis d'une très grande autorité et ma parole ne saurait être prise en défaut ; j'ai déjà dit que le mariage se fera et ton père ne saurait mentir. Maintenant je t'écoute.
- Je n'ai rien à te déclarer ! père. Et pour plusieurs raisons. Tu l'as dit toi-même, je ne connaissais pas encore les règles en vigueur dans notre village ; et quand bien même je les aurais sues, cela n'y changerait rien. Cela m'aurait aidé à mieux comprendre la vie dans ce village, tout au plus. Maintenant je te dis franchement que cela ne me fait pas plaisir parce que tu as agi sans considération aucune de ma personne, tu as donné ton consentement, pas le mien. Cela ne me fait donc plaisir ni de devoir épouser Anta, ni que tu aies donné mon consentement jusqu'à fixer même la date. Tu ne sais sans doute pas que j'aime ailleurs ! J'aime une fille depuis 3 ans et, si tout va bien, c'est elle que j'aimerais épouser.
Sidi Diop, 1977, Le cauchemar, Anthologie de la nouvelle sénégalaise.
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2
Compréhension écrite : activité 3-a
Question⚓
Quelle est la phrase par laquelle le père présente sa position au début de la discussion?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Traditions et modernisme[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
compréhension écrite : activité 3-b
Compréhension écrite : activité 3-c
Compréhension écrite : activité 4-a
Question⚓
Pourquoi peut-on dire que Malick s'est fait piéger ?
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Compréhension écrite : activité 4-b
Outils de la langue : activité 5
Outils de la langue : activité 6
Outils de la langue : activité 7
Question⚓
Justifiez l'accord de « sues » dans cette phrase :
« Tu l'as dit toi-même, je ne connaissais pas encore les règles en vigueur dans notre village ; et quand bien même je les aurais sues, cela n'y changerait rien. »
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Cinq chantiers en Afrique⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 06_CE1_Cinq_chantiers_en_Afrique.pdf
Du Sahel à l'Okavango, les États se regroupent pour faire passer le continent du noir au vert.
1. UNE GRANDE MURAILLE PLANTÉE QUI IRRIGUERA 11 PAYS
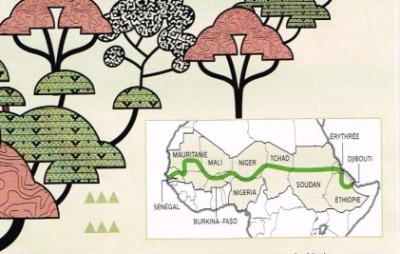
L'objectif
Initié en 2005 par onze États saharo-sahéliens, l'initiative africaine de la Grande Muraille Verte a pour but de lutter contre la désertification, de restaurer les écosystèmes et de freiner l'exode rural. Cet immense couloir végétal – quinze kilomètres de large sur 7000 kilomètres de long – devrait traverser le continent d'est en ouest en reliant Djibouti au Sénégal. Parmi les essences privilégiées : des acacias et des balanites, très résistants aux sécheresses. La reforestation de la zone permettra de développer l'agriculture et l'élevage et fournira du bois de chauffe aux habitants.
Les obstacles
Pour l'instant, la Grande Muraille n'est sortie de terre qu'au Sénégal, dans la région de Tassékéré, devenu un site de recherche international sur les effets du reboisement, mais dans les autres pays, elle a bien du mal à voir le jour. D'autant que plusieurs Etats (Mali, Soudan...) connaissent des situations politiques instables.
2. UN CANAL DE 1300 KM POUR REMETTRE EN EAU LE LAC TCHAD
L'objectif
Même s'il demeure encore l'un des plus grands d'Afrique, le lac Tchad est dix fois plus petit qu'il y a cinquante ans : 25 000 km2 en 1964 contre 2 500 km2 aujourd'hui. Le projet titanesque Transaqua, regroupant le Cameroun, le Nigéria, Le Niger, Le Tchad, La République centrafricaine et la Lybie, doit opérer un transfert des eaux de l'Oubangui, qui prend sa source en RDC, vers le lac, via les fleuves Chari et Logone. L'opération nécessiterait le creusement d'un canal de 1 350 kilomètre en République centrafricaine.
Les obstacles
Serpent de mer depuis trente ans, l'opération est loin de faire l'unanimité. Certains craignent ses impacts négatifs sur la biodiversité de l'Oubangui et du bassin du Congo. Par ailleurs, le mauvais état de l'Oubangui, dont les eaux baissent dangereusement, plaide en faveur des détracteurs de Tansaqua.
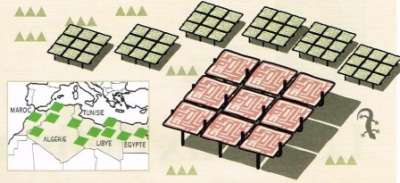
3. LE SAHARA, FUTURE CENTRALE SOLAIRE DE L'EUROPE
L'objectif
« En six heures, les déserts reçoivent plus d'énergie du soleil que ce que consomme l'ensemble du genre humain en une année. » La fondation Désertec s'appuie sur ce constat du physicien allemand Gérard Knies pour développer l'énergie solaire en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le principe est simple : installer des capteurs sur 0,75% de la surface du Sahara afin d'alimenter ces pays tout en répondant à l'augmentation des besoins européens. Un consortium d'industriels a été formé en 2009 pour se lancer dans l'aventure. Le but, d'ici à 2050, est de produire 15% de la demande d'électricité en Europe.
Les obstacles
Les travaux ont démarré au Maroc où 12 km2 de panneaux solaires ont été installés. La production d'électricité devrait être effective fin 2014. Mais celle-ci sera essentiellement destinée à l'Europe. Certaines voix taxent en effet Désertec d'écocolonialisme.
4. UNE FERME ÉOLIENNE GÉANTE AU KENYA
L'objectif
La construction du plus grand parc éolien d'Afrique devrait commencer cette année dans la région de Turkuna, dans le nord du Kenya. Les vents les plus puissants au monde y soufflent sans discontinuer, à onze mètres par seconde. Un consortium européen s'apprête à y dresser 365 éoliennes sur 165 km2, au bord du lac Turkuna. Le parc devrait produire 300 MW, soit 20% de l'électricité du pays, et sera opérationnel à la fin 2014, pour un coût de 585 millions d'euros.
Les kenyans ont tout à y gagner. Le constructeur a en effet signé avec le fournisseur public Kenya Power un contrat de vente sur vingt ans à 7,52 centimes d'euros par kW/heure, bien meilleur marché que l'énergie hydroélectrique produite dans le pays.
Les obstacles
Quelques 520 nomades habitent la zone et y font paître leurs troupeaux. Leur mode de vie, fondé sur le troc, ignore pour l'instant l'électricité, l'eau courante et le téléphone. Certains d'entre eux seront contraints de quitter leur village situé sur le tracé de la route d'acheminement du matériel pendant la durée des travaux.
5. LA PREMIÈRE RÉSERVE DU MONDE SUR 300 000 KM2
L'objectif
En mars dernier, la plus grande zone protégée de la planète a été créée. Elle s'étend sur près de 300 000 km2, à cheval sur l'Angola, Le Botswana, La Namibie, La Zambie et le Zimbabwe. A terme, KAZA TFCA (TransFrontier Conservation Area) doit relier quatorze parcs nationaux et réserves naturelles, dont le Victoria Falls National Park et le parc du delta de l'Okavango. KAZA TFCA assurera la préservation de 300 espèces de plantes, 600 oiseaux, et 200 mammifères – dont la plus grande concentration d'éléphants du monde. Les cinq Etats se sont engagés à créer des corridors de circulation pour la faune sauvage et à mettre en place des politiques de développement pour les communautés qui habitent sur le territoire, notamment grâce à l'écotourisme.
Les obstacles
La région est très densément peuplée, d'où une demande croissante de terres agricoles. Cette pression démographique pourrait aboutir à un conflit de territoire entre paysans et animaux, à remettre en cause à brève échéance la protection de la faune sauvage sur cet éden.
D'après P. Puiseux (infographie), C. Cazenave (texte), Revue Géo, n°403, 2012, p.p. 72-73.
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2-a
Compréhension écrite : activité 2-b
Compréhension écrite : activité 3
Compréhension écrite : activité 4
Compréhension écrite : activité 5-a
Question⚓
A l'issue de l'étude de ce corpus, expliquez la phrase introductive : « Du Sahel à l'Okavango, les États se regroupent pour faire passer le continent du noir au vert. »
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Cinq chantiers en Afrique[*]. Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Solution⚓
Les 5 projets présentés concernent l'environnement et donc l'écologie, symbolisée par la couleur "Verte". Le vert est aussi la couleur de l'espoir, de l'avenir. Quatre programmes concernent l'Afrique Noire. L'Afrique est souvent présentée comme ayant des difficultés et donc vivant une période "noire". Le noir est aussi la couleur de la terre "brûlée". C'est sur la base de ces symboliques attachées aux couleurs verte et noire que se forme l'expression "faire passer le continent du noir au vert". Par ailleurs, tous les programmes reposent sur des partenariats entre plusieurs pays. Le titre semble indiquer que c'est en se regroupant que le défi de l'environnement peut être gagné. L'union fait la force.a
Compréhension écrite : activité 5-b
Question⚓
Le titre « Cinq chantiers qui vont changer l'Afrique » vous semble-t-il convenir totalement aux informations que vous avez lues dans ces documents ? Pourquoi ? Quel était l'objectif recherché par ce titre ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Cinq chantiers en Afrique[*]. Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution.
Solution⚓
Les cinq chantiers n'en sont pas du tout au même niveau d'avancement. Les obstacles cités entraîneront peut-être même l'arrêt de certains programmes. Donc rien n'était encore sûr au moment de la parution de l'article. Or, le titre semble très affirmatif sur le changement à venir. L'objectif d'un tel titre est "d'accrocher le lecteur" pour lui donner envie de lire le document.
Outils de la langue : activité 6
Outils de la langue : activité 7
Enseignement mutuel⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 07_CE1_Enseignement_mutuel.pdf
Texte à lire
Lisez attentivement le texte.
Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;
J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,
Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.
Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,
De tes douces leçons je recueille le fruit ;
Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,
Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;
Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,
Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,
Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,
Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;
Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,
Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,
Tu m'apprends à parer la gaze transparente
De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,
Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,
Enrichi d'un feston ton voile virginal.
Mais aussi quelquefois, si la mélancolie
Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,
Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,
Et ton tendre regard me demande des vers.
Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,
Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;
Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,
Un talent qui me manque et que je t'ai donné.
Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2
Compréhension écrite : activité 3
Compréhension écrite : activité 4
Question⚓
Quelles sont les trois activités auxquelles Eglé initie son compagnon ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enseignement mutuel[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 5
Consigne
Relevez les mots et expressions appartenant respectivement aux champs lexicaux de la botanique (rouge) et de la broderie (bleu)dans le poème.
Si une expression ou un mot apparaît plusieurs fois, ne sélectionnez que la première apparition.
Votre réponse :
Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;
J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,
Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.
Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,
De tes douces leçons je recueille le fruit ;
Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,
Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;
Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,
Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,
Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,
Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;
Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,
Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,
Tu m'apprends à parer la gaze transparente
De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,
Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,
Enrichi d'un feston ton voile virginal.
Mais aussi quelquefois, si la mélancolie
Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,
Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,
Et ton tendre regard me demande des vers.
Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,
Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;
Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,
Un talent qui me manque et que je t'ai donné.
Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.
Réponse attendue :
Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;
J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,
Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.
Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,
De tes douces leçons je recueille le fruit ;
Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,
Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;
Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,
Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,
Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,
Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;
Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,
Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,
Tu m'apprends à parer la gaze transparente
De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,
Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,
Enrichi d'un feston ton voile virginal.
Mais aussi quelquefois, si la mélancolie
Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,
Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,
Et ton tendre regard me demande des vers.
Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,
Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;
Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,
Un talent qui me manque et que je t'ai donné.
Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.
Compréhension écrite : activité 6
Question⚓
Dans quel domaine le compagnon excelle-t-il ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enseignement mutuel[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 7
Consigne
Relevez les mots et expressions appartenant au champs lexical de la poésie.
Si une expression ou un mot apparaît plusieurs fois, ne sélectionnez que la première apparition.
Votre réponse :
Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;
J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,
Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.
Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,
De tes douces leçons je recueille le fruit ;
Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,
Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;
Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,
Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,
Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,
Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;
Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,
Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,
Tu m'apprends à parer la gaze transparente
De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,
Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,
Enrichi d'un feston ton voile virginal.
Mais aussi quelquefois, si la mélancolie
Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,
Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,
Et ton tendre regard me demande des vers.
Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,
Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;
Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,
Un talent qui me manque et que je t'ai donné.
Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.
Réponse attendue :
Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;
J'écoute mal un sot qui veut que je le craigne,
Et je sais beaucoup mieux ce qu'un ami m'enseigne.
Ainsi, charmante Eglé, par toi souvent instruit,
De tes douces leçons je recueille le fruit ;
Tantôt, quand le printemps rend aux bosquets leurs ombres,
Nous parcourons tous deux tes jardins déjà sombres ;
Là, botaniste aimable, en me montrant tes fleurs,
Tu m'apprends leurs vertus, leurs races, leurs couleurs,
Et mon cœur, attentif à des leçons si chères,
Retient surtout les noms des fleurs que tu préfères ;
Tantôt, domptant d'un mot mon orgueil aux abois,
Ta main d'un fil léger embarrasse mes doigts,
Tu m'apprends à parer la gaze transparente
De ces dessins, tracés par l'aiguille savante,
Et souvent tu souris, quand j'ai, tant bien que mal,
Enrichi d'un feston ton voile virginal.
Mais aussi quelquefois, si la mélancolie
Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,
Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,
Et ton tendre regard me demande des vers.
Alors, ô mon Eglé, si je saisis ma lyre,
Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;
Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,
Un talent qui me manque et que je t'ai donné.
Victor Hugo, Le Conservateur littéraire, 9 septembre 1820.
Compréhension écrite : activité 7
Question⚓
En dépit de sa forme, cet extrait peut être lu comme un texte argumentatif. Identifiez-en les trois parties qui correspondraient respectivement à la thèse, aux arguments et aux illustrations.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enseignement mutuel[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 8
Question⚓
Donnez au texte un titre qui en résume l'idée maîtresse.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Enseignement mutuel[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Outils de la langue : activité 9
Consigne
« Mentors » (V. 2) ; « émules » (V.8) ; « férules » (V.9).
Dans les 10 premiers vers, sélectionnez pour chacun des mots ci-dessus un synonyme.
Votre réponse :
Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;
ptembre 1820.
Réponse attendue :
Répondez, mes amis : il doit vous être doux
D'avoir pour seuls mentors des enfants comme vous ;
Leur âge, leur humeur, leurs plaisirs sont les vôtres ;
Et ces vainqueurs d'un jour, demain vaincus par d'autres,
Sont, tour à tour parés de modestes rubans,
Vos égaux dans vos jeux, vos maîtres sur les bancs.
Muets, les yeux fixés sur vos heureux émules,
Vous n'êtes point distraits par la peur des férules ;
Jamais un fouet vengeur, effrayant vos esprits,
Ne vous fait oublier ce qu'ils vous ont appris ;
ptembre 1820.
Outils de la langue : activité 10
Outils de la langue : activité 11
Outils de la langue : activité 12
Question⚓
Réécrivez le passage ci-dessous en vous mettant dans la position du narrateur externe.
Mais aussi quelquefois, si la mélancolie
Remplace dans ton cœur l'attrayante folie,
Tu t'assieds près de moi sous des bocages verts,
Et ton tendre regard me demande des vers.
Alors, (...) si je saisis ma lyre,
Mon ardeur te transporte et ma verve t'inspire ;
Tu chantes, et j'admire, à mon tour étonné,
Un talent qui me manque et que je t'ai donné.
Solution⚓
Mais aussi quelquefois, si la mélancolie
Remplace dans son cœur l'attrayante folie,
Elle s'assied près de lui sous des bocages verts,
Et son tendre regard lui demande des vers.
Alors, (...) s'il saisit sa lyre,
Son ardeur la transporte et sa verve l'inspire ;
Elle chante, et il admire, à son tour étonné,
Un talent qui lui manque et qu'il lui a donné.
La chasse en question⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 08_CE1_La_chasse_en_question.pdf
Texte à lire
J'étais à la chasse, un chevreuil innocent et heureux bondissait de joie dans les serpolets trempés de rosée sur la lisière d'un bois. Je l'apercevais de temps en temps par-dessus les tiges de bruyères, dressant les oreilles, frappant de la corne, flairant le rayon, réchauffant au soleil levant sa tiède fourrure, broutant les jeunes pousses, jouissant de sa solitude et de sa sécurité.
J'étais fils de chasseur, j'avais passé mes jeunes années avec les gardes-chasse, les curés de village et les gentilshommes de campagne qui découplaient leurs meutes avec celle de mon père. Je n'avais jamais réfléchi encore à ce brutal instinct de l'homme qui se fait de la mort un amusement, et qui prive de la vie, sans nécessité, sans justice, sans pitié et sans droit, des animaux qui auraient sur lui le même droit de chasse et de mort, s'ils étaient aussi insensibles, aussi armés, aussi féroces dans leur plaisir que lui. Mon chien quêtait ; mon fusil était sous ma main ; je tenais le chevreuil au bout du canon.
J'éprouvais bien un certain remords, une certaine hésitation à trancher du coup une telle vie, une telle joie, une telle innocence dans un être qui ne m'avait jamais fait de mal, qui savourait la même lumière, la même rosée, le même bonheur que moi, être créé par la même Providence, doué peut-être à un degré différent de la même sensibilité et de la même pensée que moi-même, enlacé peut-être des mêmes liens d'affection dans sa forêt ; cherchant son frère, attendu par sa mère, espéré par sa compagne, bramé par ses petits. Mais l'instinct machinal de l'habitude l'emporta sur la nature qui répugnait au meurtre, le coup partit. Le chevreuil tomba l'épaule cassée par la balle, bondissant en vain dans sa douleur sur l'herbe rougie de son sang.
Quand la fumée fut dissipée, je m'approchai en pâlissant et en frémissant de mon crime. Le pauvre et charmant animal n'était pas mort ; il me regardait, la tête couchée sur l'herbe, avec des yeux où nageaient des larmes. Je n'oublierai jamais ce regard auquel l'étonnement, la douleur, la mort inattendue semblaient donner des profondeurs humaines de sentiments aussi intelligibles que des paroles ; car l'œil a son langage, surtout quand il s'éteint.
Ce regard me disait clairement, avec un déchirant reproche de ma cruauté gratuite :
« Qui es-tu? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais offensé. Je t'aurais aimé peut-être ; pourquoi m'as-tu frappé à mort ? Pourquoi m'as-tu ravi ma part de ciel, de lumière, d'air, de jeunesse, de joie, de vie ? Que vont devenir ma mère, mes frères, ma compagne, mes petits qui m'attendent dans le fourré, et qui ne reverront que ces touffes de mon poil disséminées par le coup de feu, et ces gouttes de sang sur la bruyère? N'y a-t-il pas là-haut un vengeur pour moi ou un juge pour toi ? Et cependant je t'accuse, mais je pardonne ; il n'y a pas de colère dans mes yeux, tant ma nature est douce, même contre mon assassin ; il n'y a que de l'étonnement, de la douleur, des larmes. »
Voilà littéralement ce que disait le regard du chevreuil blessé. Je le comprenais, et je m'accusais comme s'il avait parlé avec la voix. « Achève-moi », semblait-il me dire encore par la plainte de ses yeux et par les inutiles frémissements de ses membres.
J'aurais voulu le guérir à tout prix ; mais je repris le fusil par pitié, et en détournant la tête, je terminai son agonie du second coup. Je rejetai alors le fusil avec horreur loin de moi, et, cette fois, je l'avoue, je pleurai. Mon chien lui-même parut attendri ; il ne flaira pas le sang, il ne remua pas du museau le cadavre, il se coucha triste à côté de moi. Nous restâmes tous les trois dans le silence, comme dans le deuil de la même mort.
C'était l'heure de midi, j'attendis que le vieux berger, qui ramène les moutons à l'étable pendant les heures brûlantes, repassât avec son troupeau sur la lisière du bois, pour lui faire emporter le chevreuil à la maison.
Je renonçai pour jamais à ce brutal plaisir du meurtre, à ce despotisme cruel du chasseur qui enlève sans nécessité, sans droit, sans pitié, l'existence à des êtres inoffensifs.
Je me jurai à moi-même de ne jamais retrancher, par caprice, une heure de soleil à ces hôtes des bois ou à ces oiseaux du ciel qui savourent comme nous la courte joie de la lumière et la conscience plus ou moins vague de l'existence.
« La vie, me dis-je, quelle qu'elle soit est trop sainte pour en faire ce jouet et ce mépris que notre incomplète civilisation nous permet d'en faire, mais que la justice et l'humanité réprouvent. »
De ce jour, je n'ai plus tué.
Alphonse de Lamartine, Les Confidences, 1790-1869
Compréhension écrite : activité 1-a
Question⚓
Qui sont les trois principaux protagonistes de cette histoire ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 1-b
Question⚓
Quel sentiment le narrateur cherche-t-il à provoquer chez le lecteur ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 1-c
Question⚓
Quelle prise de conscience le locuteur cherche-t-il à provoquer chez le lecteur ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 2-a
Question⚓
Cherchez, dans le dictionnaire ou internet la définition du mot « apologue » puis dites en quoi ce texte, malgré sa longueur fonctionne comme une sorte d'apologue.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 2-b
Compréhension écrite : activité 3-a
Sélectionnez, dans ce passage, les mots qui montrent que le narrateur personnifie l'animal.
Votre réponse :
« Mais l'instinct machinal de l'habitude l'emporta sur la nature qui répugnait au meurtre, le coup partit. Le chevreuil tomba l'épaule cassée par la balle, bondissant en vain dans sa douleur sur l'herbe rougie de son sang.
Quand la fumée fut dissipée, je m'approchai en pâlissant et en frémissant de mon crime. Le pauvre et charmant animal n'était pas mort ; il me regardait, la tête couchée sur l'herbe, avec des yeux où nageaient des larmes. »
Réponse attendue :
« Mais l'instinct machinal de l'habitude l'emporta sur la nature qui répugnait au meurtre, le coup partit. Le chevreuil tomba l'épaule cassée par la balle, bondissant en vain dans sa douleur sur l'herbe rougie de son sang.
Quand la fumée fut dissipée, je m'approchai en pâlissant et en frémissant de mon crime. Le pauvre et charmant animal n'était pas mort ; il me regardait, la tête couchée sur l'herbe, avec des yeux où nageaient des larmes. »
Compréhension écrite : activité 3-b
Question⚓
Que veut dire Lamartine de manière implicite à travers ce procédé ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 3-c
Question⚓
Quels passages du texte traduisent cette idée de manière explicite ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 4_a
Question⚓
Relevez, dans le 2e paragraphe, un passage où le narrateur dit de manière implicite que les animaux valent mieux que les hommes.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 4_b
Question⚓
Quel passage du discours prêté au chevreuil traduit la même idée ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Solution⚓
« Et cependant je t'accuse, mais je pardonne ; il n'y a pas de colère dans mes yeux, tant ma nature est douce, même contre mon assassin... »
Autre réponse acceptable : "Pourquoi m'as-tu ravi ma part de ciel, de lumière, d'air, de jeunesse, de joie, de vie ? Que vont devenir ma mère, mes frères, ma compagne"
Compréhension écrite : activité 5-a
Compréhension écrite : activité 5-b
Question⚓
Quelle phrase du texte pourrait être considérée comme la moralité de cette histoire ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La chasse en question[*].
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Outils de la langue : activité 6
Question⚓
« « Que vont devenir ma mère, mes frères, ma compagne, mes petits qui m'attendent dans le fourré, et qui ne reverront que ces touffes de mon poil disséminées par le coup de feu, et ces gouttes de sang sur la bruyère ? » »
Réécrivez ce passage en le commençant par « Le regard de l'animal semblait lui demander... »
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
J'éprouvais bien un certain remords (...) à trancher du coup une telle vie, une telle joie, une telle innocence dans un être qui ne m'avait jamais fait de mal, qui savourait la même lumière, la même rosée, le même bonheur que moi (...)
Quand la fumée fut dissipée, je m'approchai en pâlissant et en frémissant de mon crime. Le pauvre et charmant animal n'était pas mort ; il me regardait (...) Je n'oublierai jamais ce regard (...)
Ce regard me disait clairement, avec un déchirant reproche de ma cruauté gratuite : « Qui es-tu? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais offensé... »
Outils de la langue : activité 7
Question⚓
J'éprouvais bien un certain remords (...) à trancher du coup une telle vie, une telle joie, une telle innocence dans un être qui ne m'avait jamais fait de mal, qui savourait la même lumière, la même rosée, le même bonheur que moi (...)
Quand la fumée fut dissipée, je m'approchai en pâlissant et en frémissant de mon crime. Le pauvre et charmant animal n'était pas mort ; il me regardait (...) Je n'oublierai jamais ce regard (...)
Ce regard me disait clairement, avec un déchirant reproche de ma cruauté gratuite : « Qui es-tu? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais offensé... »
Réécrivez ce passage en commençant par « Elle éprouvait un certain remords... » et apportez, dans le reste du texte, toutes les modifications qu'impose ce changement de personne.
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Solution⚓
Elle éprouvait bien un certain remords (...) à trancher du coup une telle vie, une telle joie, une telle innocence dans un être qui ne lui avait jamais fait de mal, qui savourait la même lumière, la même rosée, le même bonheur qu'elle (...)
Quand la fumée fut dissipée, elle s'approcha en pâlissant et en frémissant de son crime. Le pauvre et charmant animal n'était pas mort ; il la regardait (...) Elle n'oubliera jamais ce regard (...)
Ce regard lui disait clairement, avec un déchirant reproche de sa cruauté gratuite : « Qui es-tu? Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais offensée... »
Le condamné à mort⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 09_CE1_Le_condamne_a_mort.pdf
Texte à lire
Le condamné à mort
C'était par une belle matinée d'août. Il y avait trois jours que mon procès était entamé ; trois jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs, qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre ; trois jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs du roi, passait et repassait devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante, toujours sombre et fatale. Les deux premières nuits, d'inquiétude et de terreur, je n'en avais pu dormir ; la troisième, j'en avais dormi d'ennui et de fatigue. A minuit, j'avais laissé les jurés délibérant. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot, et j'étais tombé sur-le-champ dans un sommeil profond, dans un sommeil d'oubli. C'étaient les premières heures de repos depuis bien des jours.
J'étais encore au plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on vint me réveiller. Cette fois il ne suffit point du pas lourd et des souliers ferrés du guichetier, du cliquetis de son nœud de clefs, du grincement rauque des verrous ;
– Levez-vous donc !
– J'ouvris les yeux, je me dressai effaré sur mon séant. En ce moment, par l'étroite et haute fenêtre de ma cellule, je vis au plafond du corridor voisin, seul ciel qu'il me fût donné d'entrevoir, ce reflet jaune où des yeux habitués aux ténèbres d'une prison savent si bien reconnaître le soleil. J'aime le soleil.
– Il fait beau, dis-je au guichetier.
Il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole ; puis avec quelque effort il murmura brusquement :
– C'est possible.
Je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, l'œil fixé sur cette douce réverbération dorée qui diaprait le plafond.
– Voilà une belle journée, répétai-je.
– Oui, me répondit l'homme, on vous attend.
Ce peu de mots, comme le fil qui rompt le vol de l'insecte, me rejeta violemment dans la réalité. Je revis soudain, comme dans la lumière d'un éclair, la sombre salle des assises, le fer à cheval des juges chargé de haillons ensanglantés, les trois rangs de témoins aux faces stupides, les deux gendarmes aux deux bouts de mon banc, et les robes noires s'agiter, et les têtes de la foule fourmiller au fond dans l'ombre, et s'arrêter sur moi le regard fixe de ces douze jurés, qui avaient veillé pendant que je dormais !
Je me levai ; mes dents claquaient, mes mains tremblaient et ne savaient où trouver mes vêtements, mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fis, je trébuchai comme un portefaix trop chargé. Cependant je suivis le geôlier.
Les deux gendarmes m'attendaient au seuil de la cellule. On me remit les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissai faire ; c'était une machine sur une machine.
Victor HUGO, 1829, Le dernier jour d'un condamné, Charles Gosselin.
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2
Compréhension écrite : activité 3
Compréhension écrite : activité 4
Compréhension écrite : activité 5
Outils de la langue : activité 6
Outils de la langue Activité 7a
Outils de la langue : activité 7-b
L'héritage⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 10_CE1_heritage.pdf
Texte à lire
Cela fait trois ans, mais la douleur est plus vive qu'hier et plus éphémère qu'elle ne le sera demain. Jamais je n'aurais cru qu'une aussi grande souffrance frapperait à ma porte. Pourtant, cela arriva bien. « Aujourd'hui, j'ai eu 18 ans, maman, sanglotais-je. Je me souviens encore de ta chevelure corbeau et de tes yeux saphir. Ta peau aussi blanche que la neige me manque. Chaque jour, je te vois en moi et mon cœur meurtri ne peut plus endurer mon reflet. » En tâtant la mince pellicule de cristal formée par mes larmes, je songeai qu'il était peut-être temps de rentrer. Je regarde ma montre: 23:59. Je me dirige vers la sortie et je formule mon ultime souhait : « Je donnerais tout pour te revoir une dernière fois... » me suis-je dit. Mais, je savais que cela m'était impossible.
Je faisais dos au cimetière quand soudain, un vent infernal s'abattit et une pluie torrentielle fit son entrée. Prise de panique, je courus, mais il était trop tard. Le vent me propulsa vers un arbre. Puis, plus rien. Était-ce ça la mort? Non, je ne pouvais être morte. Une voix insistante faisait écho dans mon crâne «Vraiment tout ?» dit la voix. Je cherchais d'où venait cette voix et finis par tomber sur une dame drapée d'une cape noire. Je ne pouvais voir son visage. « Es-tu vraiment prête à tout sacrifier pour un seul moment? » répéta-telle. J'étais secouée, elle me terrifiait, pourtant j'ai dit oui. Un sourire cynique se dessina sur les lèvres de la femme. Avais-je fait erreur? «Très bien, ton vœu sera exaucé, Astra. » Elle disparut. Je me réveillai, comme à chaque matin.
Drôle de rêve! Je compris vite que ce n'en était pas un. Les larmes aux yeux, je courus vers ma mère. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était là, elle souriait. « MAMAN OH MAMAN! » J'étais en sanglot. Je ne pouvais y croire. Son visage s'assombrit. « Astra, écoute-moi, dit-elle, ceci est très important. Qu'as-tu offert en échange de ma présence? » Tout ça était donc vrai... De quoi ma mère parlait-elle, était-ce possible? « Il y a 18 ans, j'accouchais d'un enfant mort-né, une petite fille. Je ne pouvais m'en détacher. Puis, une dame m'apparut. Elle me promit que si je lui offrais ce que j'avais de plus précieux, je passerais 15 années avec l'enfant. » J'étais brisée... ma mère m'avait offert sa vie. « Je ne croyais pas avoir à te dire adieu une seconde fois et pour de bon, dit ma mère en sanglot. J'ai alors réalisé ce que j'avais de plus précieux, mais il était trop tard. »
Je me réveillai et me brossai les dents, le cégep commençait aujourd'hui. Dans mon appartement, je passai à côté d'une photo de moi et d'une jolie dame : elle me ressemblait. Peut-être une parente éloignée? Cette photo était nostalgique, pourtant je n'avais aucun souvenir de l'identité de la dame à mes côtés.
Cynthia-Kimberley Gachette, Classe de français, sur https://lacroiseefr.wordpress.com/2013/09/30/lheritage/
Compréhension du texte : activité 1
Compréhension du texte : activité 2-a
Votre réponse :
Cela fait trois ans, mais la douleur est plus vive qu'hier et plus éphémère qu'elle ne le sera demain. Jamais je n'aurais cru qu'une aussi grande souffrance frapperait à ma porte. Pourtant, cela arriva bien. « Aujourd'hui, j'ai eu 18 ans, maman, sanglotais-je. Je me souviens encore de ta chevelure corbeau et de tes yeux saphir. Ta peau aussi blanche que la neige me manque. Chaque jour, je te vois en moi et mon cœur meurtri ne peut plus endurer mon reflet. » En tâtant la mince pellicule de cristal formée par mes larmes, je songeai qu'il était peut-être temps de rentrer. Je regarde ma montre: 23:59. Je me dirige vers la sortie et je formule mon ultime souhait : « Je donnerais tout pour te revoir une dernière fois... » me suis-je dit. Mais, je savais que cela m'était impossible.
Je faisais dos au cimetière quand soudain, un vent infernal s'abattit et une pluie torrentielle fit son entrée. Prise de panique, je courus, mais il était trop tard. Le vent me propulsa vers un arbre. Puis, plus rien. Était-ce ça la mort? Non, je ne pouvais être morte. Une voix insistante faisait écho dans mon crâne «Vraiment tout ?» dit la voix. Je cherchais d'où venait cette voix et finis par tomber sur une dame drapée d'une cape noire. Je ne pouvais voir son visage. « Es-tu vraiment prête à tout sacrifier pour un seul moment? » répéta-telle. J'étais secouée, elle me terrifiait, pourtant j'ai dit oui. Un sourire cynique se dessina sur les lèvres de la femme. Avais-je fait erreur? «Très bien, ton vœu sera exaucé, Astra. » Elle disparut. Je me réveillai, comme à chaque matin.
Drôle de rêve! Je compris vite que ce n'en était pas un. Les larmes aux yeux, je courus vers ma mère. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était là, elle souriait. « MAMAN OH MAMAN! » J'étais en sanglot. Je ne pouvais y croire. Son visage s'assombrit. « Astra, écoute-moi, dit-elle, ceci est très important. Qu'as-tu offert en échange de ma présence? » Tout ça était donc vrai... De quoi ma mère parlait-elle, était-ce possible? « Il y a 18 ans, j'accouchais d'un enfant mort-né, une petite fille. Je ne pouvais m'en détacher. Puis, une dame m'apparut. Elle me promit que si je lui offrais ce que j'avais de plus précieux, je passerais 15 années avec l'enfant. » J'étais brisée... ma mère m'avait offert sa vie. « Je ne croyais pas avoir à te dire adieu une seconde fois et pour de bon, dit ma mère en sanglot. J'ai alors réalisé ce que j'avais de plus précieux, mais il était trop tard. »
Je me réveillai et me brossai les dents, le cégep commençait aujourd'hui. Dans mon appartement, je passai à côté d'une photo de moi et d'une jolie dame : elle me ressemblait. Peut-être une parente éloignée? Cette photo était nostalgique, pourtant je n'avais aucun souvenir de l'identité de la dame à mes côtés.
Cynthia-Kimberley Gachette, Classe de français, sur https://lacroiseefr.wordpress.com/2013/09/30/lheritage/
Réponse attendue :
Cela fait trois ans, mais la douleur est plus vive qu'hier et plus éphémère qu'elle ne le sera demain. Jamais je n'aurais cru qu'une aussi grande souffrance frapperait à ma porte. Pourtant, cela arriva bien. « Aujourd'hui, j'ai eu 18 ans, maman, sanglotais-je. Je me souviens encore de ta chevelure corbeau et de tes yeux saphir. Ta peau aussi blanche que la neige me manque. Chaque jour, je te vois en moi et mon cœur meurtri ne peut plus endurer mon reflet. » En tâtant la mince pellicule de cristal formée par mes larmes, je songeai qu'il était peut-être temps de rentrer. Je regarde ma montre: 23:59. Je me dirige vers la sortie et je formule mon ultime souhait : « Je donnerais tout pour te revoir une dernière fois... » me suis-je dit. Mais, je savais que cela m'était impossible.
Je faisais dos au cimetière quand soudain, un vent infernal s'abattit et une pluie torrentielle fit son entrée. Prise de panique, je courus, mais il était trop tard. Le vent me propulsa vers un arbre. Puis, plus rien. Était-ce ça la mort? Non, je ne pouvais être morte. Une voix insistante faisait écho dans mon crâne «Vraiment tout ?» dit la voix. Je cherchais d'où venait cette voix et finis par tomber sur une dame drapée d'une cape noire. Je ne pouvais voir son visage. « Es-tu vraiment prête à tout sacrifier pour un seul moment? » répéta-telle. J'étais secouée, elle me terrifiait, pourtant j'ai dit oui. Un sourire cynique se dessina sur les lèvres de la femme. Avais-je fait erreur? «Très bien, ton vœu sera exaucé, Astra. » Elle disparut. Je me réveillai, comme à chaque matin.
Drôle de rêve! Je compris vite que ce n'en était pas un. Les larmes aux yeux, je courus vers ma mère. Je n'en croyais pas mes yeux. Elle était là, elle souriait. « MAMAN OH MAMAN! » J'étais en sanglot. Je ne pouvais y croire. Son visage s'assombrit. « Astra, écoute-moi, dit-elle, ceci est très important. Qu'as-tu offert en échange de ma présence? » Tout ça était donc vrai... De quoi ma mère parlait-elle, était-ce possible? « Il y a 18 ans, j'accouchais d'un enfant mort-né, une petite fille. Je ne pouvais m'en détacher. Puis, une dame m'apparut. Elle me promit que si je lui offrais ce que j'avais de plus précieux, je passerais 15 années avec l'enfant. » J'étais brisée... ma mère m'avait offert sa vie. « Je ne croyais pas avoir à te dire adieu une seconde fois et pour de bon, dit ma mère en sanglot. J'ai alors réalisé ce que j'avais de plus précieux, mais il était trop tard. »
Je me réveillai et me brossai les dents, le cégep commençait aujourd'hui. Dans mon appartement, je passai à côté d'une photo de moi et d'une jolie dame : elle me ressemblait. Peut-être une parente éloignée? Cette photo était nostalgique, pourtant je n'avais aucun souvenir de l'identité de la dame à mes côtés.
Cynthia-Kimberley Gachette, Classe de français, sur https://lacroiseefr.wordpress.com/2013/09/30/lheritage/
Compréhension du texte : activité 2
Compréhension du texte : activité 3
Compréhension du texte : activité 4
Compréhension du texte : activité 5-a
Question⚓
A quelle occasion Astra rend-elle visite à sa mère au cimetière ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant L'héritage[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension du texte : activité 5-b
Question⚓
La mère avait offert sa vie à sa fille et la fille a donné tout pour la revoir une dernière fois. Quelles valeurs enseignent-elles ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant L'héritage[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension du texte : activité 5-c
Question⚓
Qu'est-ce qui renforce la dimension de la fiction dans ce texte ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant L'héritage[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Outils de la langue : activité 6
Outils de la langue : activité 7
Gloire aux tirailleurs⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 11_CE1_Gloire_aux_tirailleurs.pdf
Texte à lire
Gloire aux tirailleurs
Vous avanciez les pas dans les pas des ancêtres
qui n'avaient jamais eu peur
vous avanciez tenant ferme dans la main
la mémoire d'un continent solidaire
vous avanciez le devoir plein le cœur
le courage vaste comme la savane
vous avanciez la dignité protégée comme le dernier grain
vous avanciez le front haut la tête droite
la gorge sans tremblement
la voix claire comme le ciel après l'orage
le poignet leste la main adroite
l'index apprivoisant la gâchette
le poing sûr dans la force des muscles
vous avanciez venus du Sud par une longue mer un océan sans fin
vous avanciez partis d'Afrique vers la France en souffrance
la France vaincue par les armes mais debout par le cœur
vous avanciez pour relever la France qu'on courbait mais rebelle
la tenir debout face à la force de l'occupant
la haine de l'occupant la folie de l'occupant
vous dont la France avait occupé les terres jusqu'aux lits de vos sœurs
vous avanciez pour inventer une nouvelle fraternité
combattre la vermine qui avait habité le cœur de l'Allemagne
la vermine qui recouvrait de son manteau de sang l'Europe
vous avanciez tirailleurs noirs soldats invincibles au sourire de paix
vous avanciez indomptables au combat
ne cédant ni un pouce de campagne ni un pouce de plage
vous avanciez plus téméraires que mille lions affamés
courageux dans le jour courageux dans la nuit
vous avanciez portant la France au fronton des héros
vous avanciez dans la boue
vous avanciez dans les épines
vous avanciez dans la soif un bout de pain taché de sang dans la bouche
vous avanciez courant contre le vent et insoumis sous la grêle
la neige et le froid dans le corps mais le soleil et la rage dans le fusil ...
Amadou Lamine Sall, août 2014
Compréhension écrite : activité 1-a
Compréhension écrite : activité 1-b
Relevez dans le texte des mots ou expressions qui justifient votre choix dans l'activité 1-a.
Votre réponse :
Vous avanciez les pas dans les pas des ancêtres
qui n'avaient jamais eu peur
vous avanciez tenant ferme dans la main
la mémoire d'un continent solidaire
vous avanciez le devoir plein le cœur
le courage vaste comme la savane
vous avanciez la dignité protégée comme le dernier grain
vous avanciez le front haut la tête droite
la gorge sans tremblement
la voix claire comme le ciel après l'orage
le poignet leste la main adroite
l'index apprivoisant la gâchette
le poing sûr dans la force des muscles
vous avanciez venus du Sud par une longue mer un océan sans fin
vous avanciez partis d'Afrique vers la France en souffrance
la France vaincue par les armes mais debout par le cœur
vous avanciez pour relever la France qu'on courbait mais rebelle
la tenir debout face à la force de l'occupant
la haine de l'occupant la folie de l'occupant
vous dont la France avait occupé les terres jusqu'aux lits de vos sœurs
vous avanciez pour inventer une nouvelle fraternité
combattre la vermine qui avait habité le cœur de l'Allemagne
la vermine qui recouvrait de son manteau de sang l'Europe
vous avanciez tirailleurs noirs soldats invincibles au sourire de paix
vous avanciez indomptables au combat
ne cédant ni un pouce de campagne ni un pouce de plage
vous avanciez plus téméraires que mille lions affamés
courageux dans le jour courageux dans la nuit
vous avanciez portant la France au fronton des héros
vous avanciez dans la boue
vous avanciez dans les épines
vous avanciez dans la soif un bout de pain taché de sang dans la bouche
vous avanciez courant contre le vent et insoumis sous la grêle
la neige et le froid dans le corps mais le soleil et la rage dans le fusil ...
Réponse attendue :
Vous avanciez les pas dans les pas des ancêtres
qui n'avaient jamais eu peur
vous avanciez tenant ferme dans la main
la mémoire d'un continent solidaire
vous avanciez le devoir plein le cœur
le courage vaste comme la savane
vous avanciez la dignité protégée comme le dernier grain
vous avanciez le front haut la tête droite
la gorge sans tremblement
la voix claire comme le ciel après l'orage
le poignet leste la main adroite
l'index apprivoisant la gâchette
le poing sûr dans la force des muscles
vous avanciez venus du Sud par une longue mer un océan sans fin
vous avanciez partis d'Afrique vers la France en souffrance
la France vaincue par les armes mais debout par le cœur
vous avanciez pour relever la France qu'on courbait mais rebelle
la tenir debout face à la force de l'occupant
la haine de l'occupant la folie de l'occupant
vous dont la France avait occupé les terres jusqu'aux lits de vos sœurs
vous avanciez pour inventer une nouvelle fraternité
combattre la vermine qui avait habité le cœur de l'Allemagne
la vermine qui recouvrait de son manteau de sang l'Europe
vous avanciez tirailleurs noirs soldats invincibles au sourire de paix
vous avanciez indomptables au combat
ne cédant ni un pouce de campagne ni un pouce de plage
vous avanciez plus téméraires que mille lions affamés
courageux dans le jour courageux dans la nuit
vous avanciez portant la France au fronton des héros
vous avanciez dans la boue
vous avanciez dans les épines
vous avanciez dans la soif un bout de pain taché de sang dans la bouche
vous avanciez courant contre le vent et insoumis sous la grêle
la neige et le froid dans le corps mais le soleil et la rage dans le fusil ...
Compréhension écrite : activité 2-a
Relevez dans le texte un passage qui pourrait se rapprocher, par la signification, du verset de Senghor dans « Niani » : « On nous tue, mais on ne nous déshonore pas ».
Votre réponse :
Vous avanciez les pas dans les pas des ancêtres
qui n'avaient jamais eu peur
vous avanciez tenant ferme dans la main
la mémoire d'un continent solidaire
vous avanciez le devoir plein le cœur
le courage vaste comme la savane
vous avanciez la dignité protégée comme le dernier grain
vous avanciez le front haut la tête droite
la gorge sans tremblement
la voix claire comme le ciel après l'orage
le poignet leste la main adroite
l'index apprivoisant la gâchette
le poing sûr dans la force des muscles
vous avanciez venus du Sud par une longue mer un océan sans fin
vous avanciez partis d'Afrique vers la France en souffrance
la France vaincue par les armes mais debout par le cœur
vous avanciez pour relever la France qu'on courbait mais rebelle
la tenir debout face à la force de l'occupant
la haine de l'occupant la folie de l'occupant
vous dont la France avait occupé les terres jusqu'aux lits de vos sœurs
vous avanciez pour inventer une nouvelle fraternité
combattre la vermine qui avait habité le cœur de l'Allemagne
la vermine qui recouvrait de son manteau de sang l'Europe
vous avanciez tirailleurs noirs soldats invincibles au sourire de paix
vous avanciez indomptables au combat
ne cédant ni un pouce de campagne ni un pouce de plage
vous avanciez plus téméraires que mille lions affamés
courageux dans le jour courageux dans la nuit
vous avanciez portant la France au fronton des héros
vous avanciez dans la boue
vous avanciez dans les épines
vous avanciez dans la soif un bout de pain taché de sang dans la bouche
vous avanciez courant contre le vent et insoumis sous la grêle
la neige et le froid dans le corps mais le soleil et la rage dans le fusil ...
Réponse attendue :
Vous avanciez les pas dans les pas des ancêtres
qui n'avaient jamais eu peur
vous avanciez tenant ferme dans la main
la mémoire d'un continent solidaire
vous avanciez le devoir plein le cœur
le courage vaste comme la savane
vous avanciez la dignité protégée comme le dernier grain
vous avanciez le front haut la tête droite
la gorge sans tremblement
la voix claire comme le ciel après l'orage
le poignet leste la main adroite
l'index apprivoisant la gâchette
le poing sûr dans la force des muscles
vous avanciez venus du Sud par une longue mer un océan sans fin
vous avanciez partis d'Afrique vers la France en souffrance
la France vaincue par les armes mais debout par le cœur
vous avanciez pour relever la France qu'on courbait mais rebelle
la tenir debout face à la force de l'occupant
la haine de l'occupant la folie de l'occupant
vous dont la France avait occupé les terres jusqu'aux lits de vos sœurs
vous avanciez pour inventer une nouvelle fraternité
combattre la vermine qui avait habité le cœur de l'Allemagne
la vermine qui recouvrait de son manteau de sang l'Europe
vous avanciez tirailleurs noirs soldats invincibles au sourire de paix
vous avanciez indomptables au combat
ne cédant ni un pouce de campagne ni un pouce de plage
vous avanciez plus téméraires que mille lions affamés
courageux dans le jour courageux dans la nuit
vous avanciez portant la France au fronton des héros
vous avanciez dans la boue
vous avanciez dans les épines
vous avanciez dans la soif un bout de pain taché de sang dans la bouche
vous avanciez courant contre le vent et insoumis sous la grêle
la neige et le froid dans le corps mais le soleil et la rage dans le fusil ...
Compréhension écrite : activité 2-b
Compréhension écrite : activité 3
Compréhension écrite : activité 4
Compréhension écrite : activité 5
Outils de la langue : activité 6-a
Question⚓
Rétablissez, dans le passage suivant, l'ellipse « afin de » à l'endroit approprié :
« vous avanciez pour relever la France qu'on courbait mais rebelle
la tenir debout face à la force de l'occupant »
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Outils de la langue : activité 6-b
Outils de la langue : activité 6-c
Question⚓
En vous aidant des réponses aux activités 6-a et 6-b, réécrivez le passage suivant en enlevant les ellipses :
« vous avanciez pour relever la France qu'on courbait mais rebelle
la tenir debout face à la force de l'occupant »
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Outils de la langue : activité 7-a
Outils de la langue : activité 7-b
Question⚓
Réécrivez le passage : la France vaincue par les armes sans en changer le sens, en commençant par : les armes...
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Gloire aux tirailleurs[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Outils de la langue : activité 7-c
Question⚓
Relevez au moins 5 valeurs qui caractérisent les tirailleurs africains dans ce poème.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant Gloire aux tirailleurs[*].
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Complément⚓
Complément :
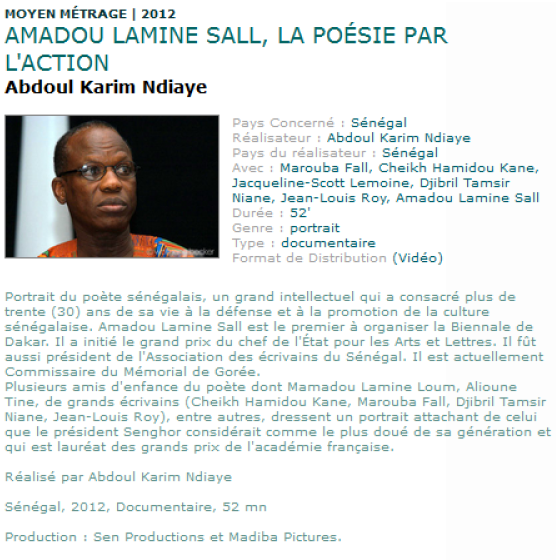
La Francophonie⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 12_CE1_La-francophonie.pdf
Texte à lire
QU'EST-CE QUE LA FRANCOPHONIE ?
Le terme francophonie est apparu pour la première fois vers 1880, lorsqu'un géographe français, Onesime Reclus, l'utilise pour désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant le français. On parle désormais de francophonie avec un « f » minuscule pour désigner les locuteurs de français et de Francophonie avec un « F » majuscule pour figurer le dispositif institutionnel organisant les relations entre les pays francophones.
274 millions de locuteurs
La francophonie, ce sont tout d'abord des femmes et des hommes qui partagent une langue commune, le français. Le dernier rapport en date de l'Observatoire de la langue française, publié en 2014, estime leur nombre à 274 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents.
Dès les premières décennies du XXe siècle, des francophones prennent conscience de l'existence d'un espace linguistique partagé, propice aux échanges et à l'enrichissement mutuel. Ils se sont constitués depuis en une multitude d'associations et regroupements dans le but de faire vivre la francophonie au jour le jour. Parmi ces organisations, on peut citer les associations professionnelles, les regroupements d'écrivains, les réseaux de libraires, d'universitaires, de journalistes, d'avocats, d'ONG et, bien sûr, de professeurs de français.
La Francophonie institutionnelle
Depuis 1970 et la création de l'agence de coopération culturelle et technique (ACCT) – devenue aujourd'hui l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) – les francophones peuvent s'appuyer sur un dispositif institutionnel voué à promouvoir la langue française et les relations de coopération entre les 77 États et gouvernements membres ou observateurs de l'OIF.
Ce dispositif est fixé par la Charte de la Francophonie adoptée en 1997 au Sommet de Hanoi (Vietnam) et révisée par la Conférence ministérielle en 2005 à Antananarivo (Madagascar) et s'appuie sur :
Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement – le Sommet de la Francophonie –, qui se réunit tous les deux ans, est la plus haute des instances politiques décisionnelles.
Le Secrétaire général de la Francophonie est la clé de voûte de ce dispositif. Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal, a occupé cette fonction de 2003 à 2014. Lors du sommet de la Francophonie de Dakar, en novembre 2014, Madame Michaëlle Jean a été élue pour être la nouvelle secrétaire générale de l'OIF.

L'Organisation internationale de la Francophonie met en œuvre la coopération multilatérale francophone au côté de quatre opérateurs :
l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF)
TV5Monde, la chaîne internationale de télévision
l'Association internationale des maires francophones (AIMF)
l'Université Senghor d'Alexandrie
La Francophonie dispose aussi d'un organe consultatif : l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).
OBJECTIFS
instauration et développement de la démocratie
prévention, gestion et règlement des conflits, et soutien à l'État de droit et aux droits de l'Homme
intensification du dialogue des cultures et des civilisations
rapprochement des peuples par leur connaissance mutuelle
renforcement de leur solidarité par des actions de coopération multilatérale en vue de favoriser l'essor de leurs économies
promotion de l'éducation et de la formation.
MISSIONS
Promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique
Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'Homme
Appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche
Développer la coopération au service du développement durable
Une attention particulière est accordée aux jeunes et aux femmes, ainsi qu'à l'accès aux TIC.
Exporté le 5-12-2014 à partir du site Web : http://www.francophonie.org
Graphique à consulter (possibilité d'utiliser la loupe)
Extrait de: http://www.francophonie.org
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2-a
Question⚓
Quelles sont les différences de sens entre « francophonie » et « Francophonie » ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La Francophonie[*]
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 2-b
Compréhension écrite : activité 2-c
Question⚓
Quels bénéfices les locuteurs tirent-ils de cet espace linguistique partagé depuis le début du XXe siècle?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La Francophonie[*]
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 2-d
Question⚓
Comment s'appelait autrefois l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La Francophonie[*]
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 2-e
Compréhension écrite : activité 2-f
Question⚓
Quelle est la périodicité de réunion du Sommet de la Francophonie ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La Francophonie[*]
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 2-g
Compréhension écrite : activité 2-h
Question⚓
Combien de personnes francophones ont été recensées au Sénégal en 2014 ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La Francophonie[*]
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 2-i
Question⚓
Parmi les pays d'Afrique noire présentés dans ce document, quel est le pays ayant le plus de grand nombre de locuteurs francophones ?
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La Francophonie.[*]
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 3
Compréhension écrite : activité 4 a
Compréhension écrite : activité 4 b
Question⚓
Si vous en avez la possibilité, connectez-vous sur ce site, pour pouvoir répondre aux questions à suivre. A quel onglet le texte sur lequel vous venez de travailler correspond-il ?
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Compréhension écrite : activité 4 c
Question⚓
Sur cette page web, quels liens hypertextes peut-on activer à partir du bandeau de gauche ?
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Outils de la langue : activité 5
Outils de la langue : activité 6 a
Question⚓
Trouvez au moins 2 mots pour illustrer chaque cas.
Le suffixe « –phonie » sert à former des mots en rapport à la voix, la parole, au fait d'écouter ou, par extension, de parler.
Le suffixe « -phone » sert à former des mots pour désigner le locuteur d'une langue.
Le suffixe ou le préfixe « -phone » sert à former des mots en rapport avec « les sons » en linguistique.
Le suffixe « -phone » sert à former des mots en rapport avec un instrument de musique ou un appareil sonore.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter votre réponse avant d'afficher la solution !
Complément⚓
Complément :
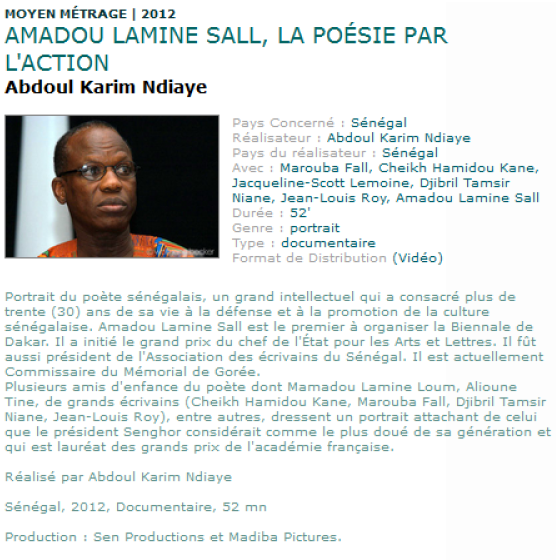
Sixième sens⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 13_CE1_sixieme_sens.pdf
Texte à lire
Sixième sens
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent
Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances,
La vie est calme, il fait beau, il est deux heures du mat,
On est quelques sourires à partager notre insouciance.
C'est ce moment-là, hors du temps, que la réalité a choisi,
Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut elle nous malmène,
Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie,
Souviens-toi de ces sourires ce ne seront plus jamais les mêmes.
Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule,
Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête il y a trop de pensées qui se bousculent
Le choc n'a duré qu'une seconde mais les ondes ne laissent personne indifférent,
« Votre fils ne marchera plus », voilà ce qu'ils ont dit à mes parents.
Alors j'ai vu de l'intérieur un monde parallèle,
Un monde où les gens te regardent avec gêne ou compassion,
Un monde où être autonome devient un objectif irréel,
Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention.
Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations,
Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut-être une très bonne occupation,
Ce monde-là respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité,
Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange : les handicapés.
On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer,
La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer,
Rappelle-toi juste que ce n'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin,
Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain.
Alors pourquoi tant d'embarras devant un mec dans un fauteuil roulant,
Ou face à une aveugle, vas-y tu peux leur parler normalement
C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas
Certains savent comme moi qu'y a des regards qu'on n'oublie pas.
C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance,
Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage,
Une frontière étroite entre souffrance et espérance.
Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage.
Quand la faiblesse physique devient une force mentale,
Quand c'est la plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment,
Quand l'envie de sourire redevient un instinct vital,
Quand on comprend que l'énergie ne se lit pas seulement dans le mouvement
Parfois la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation,
Les cinq sens des handicapés sont touchés mais c'est un sixième qui les délivre,
Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction,
Ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.
Grand Corps Malade, 2012, Patients, Seuil, Don Quichotte édition, p. 9-10
Compréhension écrite : activité 1
compréhension écrite : activité 2
Compréhension écrite : activité 3
Clandestin⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 14_CE1_Clandestin.pdf
Texte à lire
La nuit s'estompait peu à peu. Le brouillard s'élevait du fleuve et se perdait là-haut, vers les terrils boisés, ou rampait vers les squelettes des usines en ruine, sur la rive opposée. Golè suivait les quais du Brandon selon les indications de monsieur Dédé.
- Tu vas tout droit, Bamboula. Au troisième feu rouge, tu verras une place avec des palmiers. Tu peux pas te tromper : le commissariat c'est le grand bâtiment avec un drapeau français au-dessus de la porte. Y aura un flic qui fait les cent pas devant. Tu lui montres le papier, et après on te régularisera comme il faut !
Le papier ! Le papier qui permettrait à Golè de rester en France. Il ne retournerait pas au pays. Il savait que Goumé le tuerait s'il se montrait de nouveau au village. Il ne pouvait cependant pas oublier les cases autour de la maison du chef, les enfants qui jouaient dans le sable rouge, les femmes qui riaient, ou parlaient sans fin, ou se disputaient en pilant le mil. [...]
Les odeurs du village lui revenaient aussi ! Des odeurs de cuisine, celles âcres de la savane proche, des odeurs d'hommes et de femmes. Les odeurs de femmes surtout ! Des femmes bien plus belles qu'ici, avec leur grand sourire et les perles de leurs dents qui scintillaient, les mouvements qu'elles avaient en marchant qui vous donnaient envie de faire amitié du ventre, les seins nus qu'elles arboraient fièrement comme des étoiles émergeant de la grande nuit moite et mystérieuse des femmes. [...]
Les femmes du village lui étaient interdites. Ainsi le voulait la tradition. Il était le troisième frère de Goumé. Si celui-ci venait à mourir, c'est Kouma, puis Bénou, qui hériterait des femmes de l'aîné. [...]. Pour Golè, c'était la tradition. [...]
Un jour Golè se décida ! Il allait crever du ventre comme une bête ou devenir fou s'il restait plus longtemps au village à attendre, à rêver de la mort de Goumé [...]. Il prit la boîte où Goumé mettait son argent, et gagna le port de Djamay.
Là, Ali, le commerçant arabe qui venait de temps à autre au village, le mit en contact avec des marins russes. On se mit d'accord sur le prix. Le grand voyage pouvait commencer ! Golè navigua longtemps à fond de cale avec trois autres clandestins. Il perdit la notion du temps. [...] le Chinois qui venait de temps à autre leur apportait à manger. Des repas à base de riz et de pâtes que Golè et les trois autres vomissaient régulièrement. [...]
Un beau jour, Golè garda son repas. Son corps faisait corps avec le corps du bateau. Il ne se passait plus rien dans sa tête, rien qu'une grande fatigue et une somnolence qui lui permettait de s'oublier. Golè pensait qu'après tout ce n'était peut-être pas aussi désagréable de mourir comme ça. Le bateau s'immobilisa. Le bruit des machines cessa. Le silence était plus terrifiant que le grondement des moteurs. Le bateau était mort. Golè pourrirait dans son ventre.
Une nuit, le capitaine les fit sortir. Ils montèrent dans une camionnette, comme celle d'Ali. Ils roulèrent quelques heures. Le véhicule s'immobilisa. La porte s'ouvrit. Des hommes, combien exactement Golè ne savait pas, peut-être cinq ou six, les attendaient avec des barres de fer. Au premier coup, Golè s'écroula. Son cœur était dans sa tête qui cognait, cognait, cognait !
L'odeur de brûlé était suffocante, insupportable. Il passa sa main sur son crâne et ne put retenir un cri. La douleur ressemblait à un coup de poignard. Il retira sa main pleine de sang. C'était le matin ! Trois agrégats noirs fumaient à côté de lui. Des pantins grotesques et recroquevillés. Les trois hommes qui avaient partagé avec lui le ventre du bateau ! Lui-même puait l'essence. Par quel miracle le feu l'avait-il épargné ? Golè porta la main à la poche de son blouson : l'argent de la famille avait disparu.
Golè gagna un petit bois. Il s'évanouit de nouveau. Il erra deux jours et deux nuits. La douleur du crâne s'était calmée. C'est la faim qui le torturait maintenant. Il évitait les habitations, mais il lui fallait bien manger.
Un matin, il pénétra dans une maison cernée par les collines boisées. Il dévora le poulet qui se trouvait dans le frigo, et s'endormit sur le divan du salon. C'est là que monsieur Dédé le découvrit !
- Qu'est-ce que tu fous là, Bamboula ?
- Je m'appelle Golè, monsieur !
- Ouais, et ben pour moi vous vous ressemblez tous, alors autant vous appeler Bamboula : ça nous simplifierait la vie ! Bon, Bamboula, c'est quoi ton problème ?
Golè expliqua, le voyage à fond de cale, la camionnette, les hommes et leurs barres de fer !
- Ouais, ben t'es un sans-papiers quoi ! Bon, on va arranger ça : tu bosses pour moi, et après je te donnerai un papier. Tu n'auras qu'à te présenter au commissariat et tu te feras régulariser dans les règles !
Monsieur Dédé avait ri ! Golè ne comprenait pas tout, mais il savait que ça allait s'arranger. Il pourrait rester chez les Blancs. Monsieur Dédé était gentil ! Il lui disait ce qu'il devait faire dans la journée. Le soir, il revenait lui apporter à manger. [...].
Le dimanche, le Blanc lui donnait un coup de main. Une grange voisinait avec la maison. Golè déblaya les gravats qui l'encombraient, il gratta la terre entre les pierres, ponça les poutres, les teinta de colorant, il aida le Blanc à poser portes, fenêtres et vitres. Enfin, ils coulèrent une chape de béton sur le sol, dallèrent. Monsieur Dédé semblait satisfait !
- Ça va, tu l'as bien mérité ton papier !
Le Blanc remit cérémonieusement à Golè une lettre soigneusement pliée en quatre. Il lui indiqua où se trouvait le commissariat : [...] Il faisait tout à fait jour quand Golè vit le gendarme qui faisait les cent pas devant le commissariat. Golè hésita. L'homme ne lui inspirait pas confiance. Il préféra aborder une femme en uniforme qui sortait du bâtiment en baillant. Il lui tendit le papier.
- Raconte-moi ton histoire !
Elle l'avait écouté gravement.
- Je suis régularisé ?
- Quoi ?
- Mon papier, il est bon ?
La femme gendarme déchira la lettre.
- Désolé, mon pauvre vieux, t'as eu de la chance de pas cramer, t'as eu de la veine de tomber sur moi, mais pour d'autres miracles, il faudra t'adresser ailleurs! Tu sais ce qu'y avait de marqué sur ton papier ?
- Non !
- Il vaut peut-être mieux que tu ne le saches jamais, ça aurait pu te coûter très cher..., dit-elle en secouant la tête.
Adapté de Jean-Claude Renoux, 2008, « La pays des Toubabs » dans Contes pour adultes et contes noirs, Ed. Tags, http://contespourtous.centerblog.net/
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2-a
Compréhension écrite : activité 2-b
Compréhension écrite : activité 3-a
Compréhension écrite : activité-3b
Compréhension écrite : activité 4
Compréhension écrite : activité 5
Outils de la langue : activité 6
La peur⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 15_CE1_La_peur.pdf
Textes à lire
Document n°1
La peur est souvent précédée de l'étonnement, dont elle est proche, car les deux mènent à une excitation des sens de la vue et de l'ouïe. Dans les deux cas, les yeux et la bouche sont grand ouverts. L'homme effrayé commence par se figer comme une statue, immobile et sans respirer, ou s'accroupit comme instinctivement pour échapper au regard d'autrui. Le cœur bat violemment, et palpite ou bat contre les côtes... La peau est très affectée par une grande peur, nous le voyons dans la façon formidable dont elle sécrète immédiatement de la transpiration... Les poils sur la peau se dressent ; et les muscles superficiels frissonnent. Du fait du changement de rythme cardiaque, la respiration est accélérée. Les glandes salivaires agissent de façon imparfaite ; la bouche devient sèche, s'ouvrant et se fermant.
Extrait de : http://fr.wikipedia.org/wiki/Peur
Document n°2
Des situations de menaces ou de danger physique ou psychologique nous mettent dans un état émotionnel spécifique, souvent accompagné de réactions physiologiques : tremblement, sueur, maux de ventre ou d'estomac, accélération du pouls. Cet état est normal et même positif lorsqu'il nous conduit à réagir en évitant ou en surmontant un danger. En revanche lorsque la peur est la conséquence de phobies ou d'un état chronique d'anxiété sans objet, elle prend un tour pathologique.
Extrait de : http://www.psychologies.com/Dico-Psycho/Peur
Document n°3

Figure 1

Figure 2
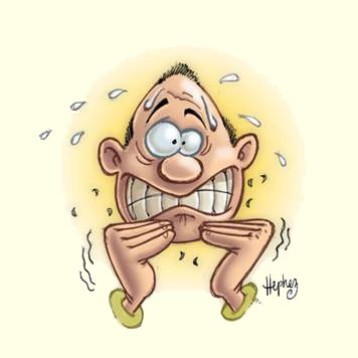
Figure 3
Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2
Compréhension écrite : activité 3
Compréhension écrite : activité 4
Compréhension écrite : activité 5
Compréhension écrite : activité 6
La guerre⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 16_CE1_La_guerre.pdf
A lire
Document A
Les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil.
Chio, l'île des vins, n'est plus qu'un sombre écueil,
Chio, qu'ombrageaient les charmilles,
Chio, qui dans les flots reflétait ses grands bois,
Ses coteaux, ses palais, et le soir quelquefois
Un chœur dansant de jeunes filles.
Tout est désert. Mais non ; seul près des murs noircis,
Un enfant aux yeux bleus, un enfant grec, assis,
Courbait sa tête humiliée ;
Il avait pour asile, il avait pour appui
Une blanche aubépine, une fleur, comme lui
Dans le grand ravage oubliée.
Ah ! pauvre enfant, pieds nus sur les rocs anguleux !
Hélas ! pour essuyer les pleurs de tes yeux bleus
Comme le ciel et comme l'onde,
Pour que dans leur azur, de larmes orageux,
Passe le vif éclair de la joie et des jeux,
Pour relever ta tète blonde,
Que veux-tu ? Bel enfant, que te faut-il donner
Pour rattacher gaîment et gaîment ramener
En boucles sur ta blanche épaule
Ces cheveux, qui du fer n'ont pas subi l'affront,
Et qui pleurent épars autour de ton beau front,
Comme les feuilles sur le saule ?
Qui pourrait dissiper tes chagrins nébuleux ?
Est-ce d'avoir ce lys, bleu comme tes yeux bleus,
Qui d'Iran borde le puits sombre ?
Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand,
Qu'un cheval au galop met, toujours en courant,
Cent ans à sortir de son ombre ?
Veux-tu, pour me sourire, un bel oiseau des bois,
Qui chante avec un chant plus doux que le hautbois,
Plus éclatant que les cymbales ?
Que veux-tu ? fleur, beau fruit, ou l'oiseau merveilleux ?
- Ami, dit l'enfant grec, dit l'enfant aux yeux bleus,
Je veux de la poudre et des balles.
Victor Hugo,1829, Les Orientales.
Document B
Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque côté ; ensuite la mousqueterie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque.
Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter des Te Deum chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d'abord un village voisin ; il était en cendres : c'était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs ; d'autres, à demi brûlées, criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés.
Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village : il appartenait à des Bulgares, et des héros abares l'avaient traité de même.
Extrait de Voltaire, 1759, Candide ou l'optimisme.
Document C
« De retour d'une guerre qu'il voulait la dernière, Hector, le général troyen, prêt à tout pour éviter une nouvelle guerre contre les Grecs, est poussé par Demokos et Priam (respectivement poète et roi de Troie qui appellent de tous leurs vœux une nouvelle guerre) à prononcer le traditionnel discours aux morts. Ils espèrent que ce rituel lui fera changer d'avis... »
Hector : Ô vous qui ne nous entendez pas, qui ne nous voyez pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège. Nous sommes les vainqueurs. Cela vous est bien égal, n'est-ce pas ? Vous aussi vous l'êtes. Mais, nous, nous sommes les vainqueurs vivants. C'est ici que commence la différence. C'est ici que j'ai honte. Je ne sais si dans la foule des morts on distingue les morts vainqueurs par une cocarde. Les vivants, vainqueurs ou non, ont la vraie cocarde, la double cocarde. Ce sont leurs yeux. Nous, nous avons deux yeux, mes pauvres amis. Nous voyons le soleil. Nous faisons tout ce qui se fait dans le soleil. Nous mangeons. Nous buvons... Et dans le clair de lune !... Nous couchons avec nos femmes... Avec les vôtres aussi...
Demokos : Tu insultes les morts, maintenant ?
Hector : Vraiment, tu crois ?
Demokos : Ou les morts, ou les vivants.
Hector : Il y a une distinction...
Priam : Achève, Hector... Les Grecs débarquent...
Hector : J'achève... Ô vous qui ne sentez pas, qui ne touchez pas, respirez cet encens, touchez ces offrandes. Puisque enfin c'est un général sincère qui vous parle, apprenez que je n'ai pas une tendresse égale, un respect égal pour vous tous. Tout morts que vous êtes, il y a chez vous la même proportion de braves et de peureux que chez nous qui avons survécu et vous ne me ferez pas confondre, à la faveur d'une cérémonie, les morts que j'admire avec les morts que je n'admire pas. Mais ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que la guerre me semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser les humains et que je n'admets pas plus la mort comme expiation au lâche que comme récompense aux héros. Aussi, qui que vous soyez, vous absents, vous inexistants, vous oubliés, vous sans occupation, sans repos, sans être, je comprends en effet qu'il faille en fermant ces portes excuser près de vous ces déserteurs que sont les survivants, et ressentir comme un privilège et un vol ces deux biens qui s'appellent, de deux noms dont j'espère que la résonance ne vous atteint jamais, la chaleur et le ciel.
Jean Giraudoux, 1935, La guerre de Troie n'aura pas lieu, Paris, Grasset.
Document D

Compréhension écrite : activité 1
Compréhension écrite : activité 2-a
Compréhension écrite : activité 2-b
Compréhension écrite : activité 2-c
Question⚓
Lequel des 3 textes est plus proche du tableau de Picasso ? Relevez un passage pour justifier votre réponse.
Vous pouvez relire le texte en cliquant sur le lien suivant La Guerre.[*] Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la solution.
Solution⚓
Document B
« Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sanglantes ; là des filles éventrées après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros rendaient les derniers soupirs ; d'autres, à demi brûlées, criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre à côté de bras et de jambes coupés.»
Compréhension écrite : activité 3-a
Compréhension écrite : activité 3-b
Outils de la langue : activité 4
Question⚓
Réécrivez le passage suivant en remplaçant « nous » par « je » et « vous » par « toi ».
« Ô vous qui ne nous entendez pas, qui ne nous voyez pas, écoutez ces paroles, voyez ce cortège. Nous sommes les vainqueurs. Cela vous est bien égal, n'est-ce pas ? Vous aussi vous l'êtes. Mais, nous, nous sommes les vainqueurs vivants. C'est ici que commence la différence (...) Nous, nous avons deux yeux, mes pauvres amis. Nous voyons le soleil. Nous faisons tout ce qui se fait dans le soleil. Nous mangeons. Nous buvons... Et dans le clair de lune !... Nous couchons avec nos femmes... Avec les vôtres aussi... »
Vous pouvez utiliser la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la solution !
Solution⚓
« Ô toi qui ne m'entends pas, qui ne me vois pas, écoute ces paroles, vois ce cortège. Je suis le vainqueur. Cela t'est bien égal, n'est-ce pas ? Toi aussi tu l'es. Mais, moi, je suis le vainqueur vivant. C'est ici que commence la différence (...) Moi, j'ai deux yeux, mon pauvre ami. Je vois le soleil. Je fais tout ce qui se fait dans le soleil. Je mange. Je bois... Et dans le clair de lune !... Je couche avec ma femme... Avec la tienne aussi... »
Smartphones et autres...⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 17_CE1_smartphones.pdf
Méthode :
Lisez les 3 textes ci-dessous avant de réaliser les exercices.
Texte n°1 à lire⚓
CES SMARTPHONES QUI GOBENT L'ATTENTION
Que ferait-on sans nos appareils intelligents? Aujourd'hui, les téléphones sont à la fois des agendas, des messageries, des plate-formes de discussions, des consoles de jeux, etc. On en oublierait presque la fonction de téléphonie... Et si les millions d'applications ont permis à l'être humain d'améliorer son quotidien et sa santé, il n'en reste pas moins que beaucoup de gens commencent à craindre une obsession envers les petites machines. Parce que l'attention portée au smartphone nous fait oublier tout le reste. Le journaliste québécois Patrick Lagacé a fait récemment une expérience : 9 jours sans "appareil intelligent" (en anglais smartphone) et sans connexion Internet. Évidemment, ce travailleur de l'information a ragé de ne pouvoir avoir accès au flot d'actualités comme à l'accoutumée, mais son expérimentation lui a permis de réfléchir sur la question et d'écrire une série d'articles sur notre rapport aux iPhones aujourd'hui.

CES SMARTPHONES QUI GOBENT L'ATTENTION
Que ferait-on sans nos appareils intelligents? Aujourd'hui, les téléphones sont à la fois des agendas, des messageries, des plate-formes de discussions, des consoles de jeux, etc. On en oublierait presque la fonction de téléphonie... Et si les millions d'applications ont permis à l'être humain d'améliorer son quotidien et sa santé, il n'en reste pas moins que beaucoup de gens commencent à craindre une obsession envers les petites machines. Parce que l'attention portée au smartphone nous fait oublier tout le reste.
Le journaliste québécois Patrick Lagacé a fait récemment une expérience : 9 jours sans "appareil intelligent" (en anglais smartphone) et sans connexion Internet. Évidemment, ce travailleur de l'information a ragé de ne pouvoir avoir accès au flot d'actualités comme à l'accoutumée, mais son expérimentation lui a permis de réfléchir sur la question et d'écrire une série d'articles sur notre rapport aux iPhones aujourd'hui.
LIBRE ET ESCLAVE
Ses échanges sur la question, notamment avec un humoriste et une animatrice de radio, sont révélateurs. Pour l'humoriste, les téléphones ont conduit à un individualisme terrifiant où les gens n'ont aucune gêne à interrompre une conversation ou un dîner pour répondre au dernier courriel ou message Facebook reçu. La seconde, l'animatrice, admet que le téléphone l'a rendue à la fois libre et esclave. Formidable plate-forme sociale, le téléphone est devenu essentiel dans sa vie et elle ne peut s'empêcher de répondre et d'avoir le téléphone à la portée de la main, y compris au lit.
Le sujet suscite des réactions partout. Un blogue américain sur la technologie n'aura jamais recueilli autant de commentaires que sur ce sujet. Étonnamment, même ladite «génération numérique», trouve frustrante les comportements très individualistes des gens qui ont toujours le nez à leur appareil.
Comme l'explique Patrick Lagacé, des chercheurs américains prétendent avoir découvert pourquoi nous sommes aussi obsédés par nos appareils. Chaque message ferait que notre cerveau sécréterait un peu de dopamine – créant cette excitation qui nous enchaîne à nos machines, à la manière d'un chien qui reçoit un biscuit pour chaque bonne action qu'il fait.
UNE DISTRACTION AUX GRAVES CONSÉQUENCES
Et si cette distraction n'était que liée à quelques moments lors de repas ou dans des conversations, cela serait irritant sans plus. Mais celle-ci devient de plus en plus dangereuse : de jeunes Américains ont été blessés par des véhicules en traversant la rue ou en tombant alors qu'ils étaient trop absorbés par leur téléphone. Ce phénomène étant planétaire, il n'est alors pas surprenant de voir un parc d'attractions chinois instaurer récemment une ligne piétonnière départageant ceux se servant de leur smartphone en marchant et ceux qui ne le font pas !
Les psychologues sont également effarés d'observer à quel point les téléphones sont en train de gober toute l'attention des parents. Ils seraient de plus en plus nombreux à délaisser leurs responsabilités parentales au profit de leur téléphone intelligent. Évidemment, les tout-petits, en quête de considération, essaieraient de l'obtenir en tentant d'arracher l'appareil des mains de maman ou papa. Ce qui provoque parfois de brusques confrontations. Les psychologues suggèrent donc aux parents, s'ils doivent absolument utiliser leur téléphone pour envoyer un message, de se mettre une limite de temps et de la dire à l'enfant, mais ils recommandent aux adultes de ranger leurs appareils intelligents en présence de leur progéniture.
Heureusement les professeurs, eux, sont censés débrancher leur mobile avant d'entrer en classe ! Mais en est-on vraiment sûr ?
PRÉVENTION, DÉSINTOXICATION
Puisque les appareils intelligents ne sont pas prêts de disparaître de nos vies, il est nécessaire de mener une réflexion sérieuse sur l'usage que nous faisons de nos téléphones. Il est temps de travailler le contrôle de soi vis-à-vis de ces machines afin d'être plus attentif aux relations interpersonnelles avec les personnes réelles qui nous entourent et donc, il faut apprendre à lâcher un peu l'écran. On n'a pas encore vu d'écoles mettre cette habileté au programme, mais plusieurs établissement définissent aujourd'hui des aires spécifiques où l'utilisation de ces appareils est permise et d'autres où ce n'est pas possible.
Alexandre Roberge, 12 novembre 2014, téléchargé sur Thot Cursus : https://cursus.edu/
Texte n°2 à lire⚓
Quels peuvent être les effets d'une exposition aux champs électromagnétiques, comme ceux générés par les antennes-relais de téléphonie mobile qui fleurissent sur les toits des immeubles et parfois des écoles ? Existe-t-il un réel risque sanitaire pour les riverains, comme le soupçonnent certaines associations ?
LE MONDE | 04.04.2013 à 11h30 • Mis à jour le 05.04.2013 à 08h17 | Par Sophie Landrin
Pour la première fois, une étude sur des jeunes rats, conduite par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris) et l'université de Picardie Jules-Verne, publiée par la revue Environnement Science and Pollution Research et rendue publique mercredi 3 avril, conclut à des effets biologiques des radiofréquences sur les fonctions de l'équilibre énergétique. Le sommeil, la régulation thermique et la prise alimentaire sont perturbés.
Le niveau d'exposition auquel ont été soumis les rats, expliquent les chercheurs, correspond à celui rencontré à proximité d'une antenne-relais. Treize jeunes rats ont été exposés en continu pendant six semaines à des ondes d'une fréquence de 900 MHz et d'une intensité de 1 volt par mètre (V/m), beaucoup plus faible que les seuils légaux. Un groupe témoin de 11 rats a été constitué, non soumis à ces champs électromagnétiques.
LES RATS RÉDUISENT LEUR STRATÉGIE DE REFROIDISSEMENT
Les chercheurs soulignent que les rongeurs ont un comportement alimentaire et suivent des rythmes biologiques assez similaires à ceux des nouveau-nés et que leur régulation thermique est transposable à l'homme. L'expérience a été répétée deux fois, avec des résultats cohérents.
L'expérimentation montre des effets des radiofréquences sur la régulation thermique : lorsqu'ils sont soumis à une augmentation de la température ambiante, les rats exposés aux ondes réduisent leur stratégie de refroidissement. Les animaux contractent leurs vaisseaux périphériques pour conserver la chaleur (vasoconstriction), comme s'ils ressentaient une sensation de froid, alors qu'ils ont plus chaud. Ils économisent leur énergie, comme s'ils en avaient un besoin accru.
Pourquoi ? "Nous n'avons pas de réponse. Nous constatons seulement que l'animal ne ressent pas la chaleur. L'adaptation à la température est modifiée", explique René de Seze, directeur de recherche à l'Ineris.
UNE PRISE ALIMENTAIRE PLUS IMPORTANTE
Par ailleurs, les chercheurs ont observé que les animaux exposés n'avaient pas la même sensation de satiété que les rats non exposés. Ils constatent une prise alimentaire plus importante chez les rats soumis aux ondes. Les mécanismes d'économie d'énergie chez les rats exposés pourraient donc conduire à une augmentation de la masse corporelle.
Dernier enseignement : les rats soumis aux radiofréquences présentent un fractionnement du sommeil paradoxal, comme si les animaux étaient en état d'alerte. Les chercheurs soulignent qu'il ne s'agit pas de troubles du sommeil au sens strict, mais précisent que des perturbations du sommeil paradoxal pourraient "engendrer des difficultés de mémorisation ou des troubles de l'humeur chez l'homme".
"Ce que nous constatons, c'est qu'à de très faibles niveaux d'exposition, les effets sont réels sur le métabolisme, explique René de Seze. Il faut maintenant que d'autres laboratoires mènent des expériences similaires pour confirmer ou infirmer nos conclusions."
Texte n°3 à lire⚓
LES ONDES ÉLECTROMAGNÉTIQUES SONT-ELLES NOCIVES ?
Les ondes électromagnétiques sont générées, à des degrés divers, par de nombreux appareils (radios, micro-ondes, téléphones sans fil et portables, systèmes Wifi ou Wimax, radars, télécommandes, micros sans fil, etc.) et par les antennes-relais. En 2009, l'Agence nationale sanitaire (Anses) avait acté l'absence de preuves sur la nocivité des radiofréquences, tout en recommandant déjà la réduction des expositions dès que c'est possible, principalement pour l'usage des téléphones portables, la source d'exposition la plus élevée. En mai 2011, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) classait les champs électromagnétiques radiofréquences (de 9 à 300 GHz) comme "peut-être cancérogènes". En octobre 2013, l'Anses recommandait de limiter l'exposition aux ondes. En particulier celles des téléphones mobiles, surtout pour les enfants et les utilisateurs intensifs, qui passent chaque jour plus d'une quarantaine de minutes au téléphone.
Aujourd'hui, la France vient d'adopter la Loi Abeille "relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques" (...) Cette Loi est la première, en France, à instituer une démarche de précaution face aux risques sanitaires potentiels générés par les antennes-relais, téléphones mobiles, et autres technologies sans fil.
Extrait de Lafo. C, Ondes de téléphones mobiles : la nouvelle loi va-t-elle protéger notre santé?, Sud-Ouest, publié le 04/02/2015 sur : http://www.sudouest.fr/2015/02/04/ondes-de-telephones-mobiles-que-peut-faire-la-loi-abeille-pour-notre-sante-1819136-710.php
Compréhension écrite : activité 1⚓
Compréhension écrite : activité 2⚓
Relisez le texte 1 et répondez aux questions.
Compréhension écrite : activité 3⚓
Compréhension écrite : activité 4⚓
Question⚓
Certaines personnes préfèrent utiliser le téléphone portable pour communiquer avec leurs proches, d'autres utilisent le téléphone fixe et d'autres préfèrent l'Internet. Et vous que préférez-vous utiliser ?
Rédigez un court texte dans lequel vous présenterez des arguments pour justifier votre point de vue.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la solution !
Solution⚓
Plan possible
Le téléphone portable apparaît incontournable dans le monde d'aujourd'hui. Il permet à n'importe qui, où qu'il soit, d'être en contact avec le reste du monde en permanence. Parmi ses avantages, on peut citer:
Il est utile pour les appels en cas d'urgence.
C'est un moyen de communication rapide et efficace, permettant de relier les individus partout dans le monde.
C'est un moyen économique qui évite les déplacements coûteux.
Les smartphones, qui sont aussi des téléphones portables, permettent en plus de bénéficier de toutes les facilités des applications numériques en se connectant à l'Internet et d'échanger par sa messagerie électronique ou via les réseaux sociaux.
Cependant, le téléphone portable a aussi des inconvénients, notamment :
il est encore trop cher pour les communications internationales,
il représente un danger pour la santé en raison des ondes électromagnétiques,
des études montrent par ailleurs que les smartphones peuvent nuire à l'attention en envahissant notre vie.
En conclusion, le téléphone portable doit être utilisé avec modération, en particulier par les jeunes enfants qui sont les plus vulnérables aux ondes électromagnétiques.
Outils de la langue : activité 5⚓
Des bonnes manières⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 18_CE1_bonnes_manieres.pdf
Texte à lire
Un homme entre dans la boutique. La soixantaine, le visage fermé, il désigne un robot culinaire du doigt : «C'est combien ? »
N'esquissant pas l'ombre d'une formule de politesse, il n'a pas même croisé le regard du vendeur, qui est en réalité le proprio. Il se trouve que c'est aussi mon beau-frère, auquel j'étais venu rendre une cafetière qu'il m'avait prêtée.
Habitué à ce genre d'incivilité, lui ne bronche pas, se contentant de répondre sèchement. Puis entre un autre homme pour réclamer un renseignement. Il l'obtient et part sans dire merci. Et ça continue ainsi jusqu'à ce que je m'en aille à mon tour, tandis qu'affleurent à la surface de ma mémoire mes années de cauchemar dans le service à la clientèle, à vendre des vélos, des chaussures, de la bière. Des souvenirs dans le Vieux-Québec et des jeans sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal.
Le client ayant fini par croire qu'il est effectivement roi et que son noble statut le dispense de toute délicatesse, il déshumanise couramment un personnel qui est ainsi réduit à une forme de servitude. M'étant fait braquer alors que je travaillais dans cette artère montréalaise, j'exagérerais à peine en disant que le voleur n'a pas été le plus désagréable des personnages que j'ai croisés au fil des ans. Il avait pris le temps d'essayer deux pantalons et avait au moins eu la décence d'être poli avant de me mettre son arme sous le nez.
Ce qui n'est pas le cas du type qui coupe la file d'attente à l'épicerie, de l'automobiliste qui refuse de vous laisser vous insérer dans le trafic et garde le regard braqué vers l'avant, sans parler de tous les anonymes qui infectent le Web avec leurs commentaires immondes, réclamant que la liberté de parole soit aussi celle d'injurier.
Pour ce qui est du client insolent, il bafoue les règles d'une essentielle politesse qui n'est pas qu'un lubrifiant social : c'est un ciment. C'est elle qui régule la société et rend les rapports avec les autres tolérables. Elle est aussi un indicateur de valeurs communes, nécessaires au vivre-ensemble. À commencer par une idée de respect et d'égalité entre les êtres.
Experte en la matière, Dominique Picard est professeure de psychologie sociale et auteure de deux ouvrages sur le sujet. Ayant passé en revue les observations des sociologues et psychanalystes et étudié l'histoire des traités de savoir-vivre à l'usage des différentes générations, elle expose que ces bonnes manières conspuées par les soixante-huitards - sous prétexte qu'il s'agissait d'un instrument d'exclusion sociale bourgeois - ne peuvent être écartées sans que cela provoque l'effondrement d'une certaine paix sociale.
J'oserais même avancer que c'est désormais l'impolitesse qui est le nouvel outil d'exclusion, à l'avantage du plus fort en gueule et du plus brutal. La courtoisie devient un indice de faiblesse qu'on évite de montrer.
En même temps, on connaît la règle : il faut être poli. Ce qui explique peut-être que c'est derrière le volant et dans l'anonymat de la foule ou du Web que foisonne le plus librement l'impolitesse. Ou alors dans le rapport de force client-vendeur. Là, on peut enfin être soi-même, sans le théâtre que nécessite la vie en société.
La recherche de vérité et d'authenticité que souhaitaient les détracteurs du savoir-vivre ne donne cependant pas le résultat escompté : nous rendre tous égaux. Comme de nombreux idéaux dévoyés par l'hyper-individualisme, le rejet des bonnes manières est devenu l'expression du culte de soi, de la volonté de chacun de « jouir sans entraves », sans égard aux autres.
Et voilà qu'on découvre avec horreur que nos cours d'école en subissent le contrecoup, que l'intimidation n'y est plus anecdotique, mais quotidienne. Comme si les enfants nous tendaient un miroir, nous montrant qu'on a beau leur répéter d'être polis, les paroles s'envolent. Mais le mauvais exemple reste.
Extrait de David Desjardins dans https://www.lactualite.com
Compréhension écrite : activité 1⚓
Répondez aux questions.
Compréhension écrite : activité 2⚓
Exercice 1
Consigne
Surlignez, dans les deux paragraphes, les détails qui montrent l'incivilité du client.
Votre réponse :
Un homme entre dans la boutique. La soixantaine, le visage fermé, il désigne un robot culinaire du doigt : «C'est combien ? »
N'esquissant pas l'ombre d'une formule de politesse, il n'a pas même croisé le regard du vendeur, qui est en réalité le proprio. Il se trouve que c'est aussi mon beau-frère, auquel j'étais venu rendre une cafetière qu'il m'avait prêtée.
Réponse attendue :
Un homme entre dans la boutique. La soixantaine, le visage fermé, il désigne un robot culinaire du doigt : «C'est combien ? »
N'esquissant pas l'ombre d'une formule de politesse, il n'a pas même croisé le regard du vendeur, qui est en réalité le proprio. Il se trouve que c'est aussi mon beau-frère, auquel j'étais venu rendre une cafetière qu'il m'avait prêtée.
Exercice 2
Question⚓
« Puis entre un autre homme pour réclamer un renseignement » (3e paragraphe).
Que traduit l'emploi du verbe « réclamer » ? Quel verbe aurait été employé dans une situation ordinaire ?
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la Solution.
Exercice 2
Question⚓
Le manque de savoir-vivre se manifeste dans les commerces, mais aussi dans d'autres espaces. Lesquels ?
Relisez ci nécessaire le texte Des bonnes manières[*] avant de répondre à la question.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la Solution.
Exercice 3
Question⚓
Selon l'auteur, pourquoi les clients ne se sentent-ils pas obligés d'être polis ?
Relisez ci nécessaire le texte Des bonnes manières[*] avant de répondre à la question.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la Solution.
Compréhension écrite : activité 3⚓
Exercice 1
Consigne
Relevez dans le paragraphe ci-dessous une métaphore qui rappelle que le mot « politesse », au XVIe, signifiait «état de ce qui est lisse », donc de la même famille que le verbe « polir ».
Votre réponse :
Pour ce qui est du client insolent, il bafoue les règles d'une essentielle politesse qui n'est pas qu'un lubrifiant social : c'est un ciment. C'est elle qui régule la société et rend les rapports avec les autres tolérables. Elle est aussi un indicateur de valeurs communes, nécessaires au vivre-ensemble. À commencer par une idée de respect et d'égalité entre les êtres.
Réponse attendue :
Pour ce qui est du client insolent, il bafoue les règles d'une essentielle politesse qui n'est pas qu'un lubrifiant social : c'est un ciment. C'est elle qui régule la société et rend les rapports avec les autres tolérables. Elle est aussi un indicateur de valeurs communes, nécessaires au vivre-ensemble. À commencer par une idée de respect et d'égalité entre les êtres.
Explication
L'essentielle politesse qui n'est pas qu'un lubrifiant social.
A retenir :
grossier peut signifier impoli mais aussi « sans finesse ». Ainsi, on peut parler de «pierre grossière » par opposition à « pierre polie ».
Exercice 2
Exercice 3
Consigne
Quelle expression, dans le 7e paragraphe, montre que l'auteur ne partage pas cette perception ?
Votre réponse :
Experte en la matière, Dominique Picard est professeure de psychologie sociale et auteure de deux ouvrages sur le sujet. Ayant passé en revue les observations des sociologues et psychanalystes et étudié l'histoire des traités de savoir-vivre à l'usage des différentes générations, elle expose que ces bonnes manières conspuées par les soixante-huitards - sous prétexte qu'il s'agissait d'un instrument d'exclusion sociale bourgeois - ne peuvent être écartées sans que cela provoque l'effondrement d'une certaine paix sociale.
Réponse attendue :
Experte en la matière, Dominique Picard est professeure de psychologie sociale et auteure de deux ouvrages sur le sujet. Ayant passé en revue les observations des sociologues et psychanalystes et étudié l'histoire des traités de savoir-vivre à l'usage des différentes générations, elle expose que ces bonnes manières conspuées par les soixante-huitards - sous prétexte qu'il s'agissait d'un instrument d'exclusion sociale bourgeois - ne peuvent être écartées sans que cela provoque l'effondrement d'une certaine paix sociale.
Compréhension écrite : activité 4⚓
Compréhension écrite : activité 5⚓
Exercice 2
Exercice 3
Outils de la langue : activité 6⚓
Consigne
Sélectionnez en rouge tous les mots et expressions du texte, synonymes du mot « impolitesse ».
Sélectionnez en bleu des synonymes de « politesse »
Votre réponse :
Un homme entre dans la boutique. La soixantaine, le visage fermé, il désigne un robot culinaire du doigt : «C'est combien ? »
N'esquissant pas l'ombre d'une formule de politesse, il n'a pas même croisé le regard du vendeur, qui est en réalité le proprio. Il se trouve que c'est aussi mon beau-frère, auquel j'étais venu rendre une cafetière qu'il m'avait prêtée.
Habitué à ce genre d'incivilité, lui ne bronche pas, se contentant de répondre sèchement. Puis entre un autre homme pour réclamer un renseignement. Il l'obtient et part sans dire merci. Et ça continue ainsi jusqu'à ce que je m'en aille à mon tour, tandis qu'affleurent à la surface de ma mémoire mes années de cauchemar dans le service à la clientèle, à vendre des vélos, des chaussures, de la bière. Des souvenirs dans le Vieux-Québec et des jeans sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal.
Le client ayant fini par croire qu'il est effectivement roi et que son noble statut le dispense de toute délicatesse, il déshumanise couramment un personnel qui est ainsi réduit à une forme de servitude. M'étant fait braquer alors que je travaillais dans cette artère montréalaise, j'exagérerais à peine en disant que le voleur n'a pas été le plus désagréable des personnages que j'ai croisés au fil des ans. Il avait pris le temps d'essayer deux pantalons et avait au moins eu la décence d'être poli avant de me mettre son arme sous le nez.
Ce qui n'est pas le cas du type qui coupe la file d'attente à l'épicerie, de l'automobiliste qui refuse de vous laisser vous insérer dans le trafic et garde le regard braqué vers l'avant, sans parler de tous les anonymes qui infectent le Web avec leurs commentaires immondes, réclamant que la liberté de parole soit aussi celle d'injurier.
Pour ce qui est du client insolent, il bafoue les règles d'une essentielle politesse qui n'est pas qu'un lubrifiant social : c'est un ciment. C'est elle qui régule la société et rend les rapports avec les autres tolérables. Elle est aussi un indicateur de valeurs communes, nécessaires au vivre-ensemble. À commencer par une idée de respect et d'égalité entre les êtres.
Experte en la matière, Dominique Picard est professeure de psychologie sociale et auteure de deux ouvrages sur le sujet. Ayant passé en revue les observations des sociologues et psychanalystes et étudié l'histoire des traités de savoir-vivre à l'usage des différentes générations, elle expose que ces bonnes manières conspuées par les soixante-huitards - sous prétexte qu'il s'agissait d'un instrument d'exclusion sociale bourgeois - ne peuvent être écartées sans que cela provoque l'effondrement d'une certaine paix sociale.
J'oserais même avancer que c'est désormais l'impolitesse qui est le nouvel outil d'exclusion, à l'avantage du plus fort en gueule et du plus brutal. La courtoisie devient un indice de faiblesse qu'on évite de montrer.
En même temps, on connaît la règle : il faut être poli. Ce qui explique peut-être que c'est derrière le volant et dans l'anonymat de la foule ou du Web que foisonne le plus librement l'impolitesse. Ou alors dans le rapport de force client-vendeur. Là, on peut enfin être soi-même, sans le théâtre que nécessite la vie en société.
La recherche de vérité et d'authenticité que souhaitaient les détracteurs du savoir-vivre ne donne cependant pas le résultat escompté : nous rendre tous égaux. Comme de nombreux idéaux dévoyés par l'hyper-individualisme, le rejet des bonnes manières est devenu l'expression du culte de soi, de la volonté de chacun de « jouir sans entraves », sans égard aux autres.
Et voilà qu'on découvre avec horreur que nos cours d'école en subissent le contrecoup, que l'intimidation n'y est plus anecdotique, mais quotidienne. Comme si les enfants nous tendaient un miroir, nous montrant qu'on a beau leur répéter d'être polis, les paroles s'envolent. Mais le mauvais exemple reste.
Extrait de David Desjardins dans http://www.lactualite.com
Réponse attendue :
Un homme entre dans la boutique. La soixantaine, le visage fermé, il désigne un robot culinaire du doigt : «C'est combien ? »
N'esquissant pas l'ombre d'une formule de politesse, il n'a pas même croisé le regard du vendeur, qui est en réalité le proprio. Il se trouve que c'est aussi mon beau-frère, auquel j'étais venu rendre une cafetière qu'il m'avait prêtée.
Habitué à ce genre d'incivilité, lui ne bronche pas, se contentant de répondre sèchement. Puis entre un autre homme pour réclamer un renseignement. Il l'obtient et part sans dire merci. Et ça continue ainsi jusqu'à ce que je m'en aille à mon tour, tandis qu'affleurent à la surface de ma mémoire mes années de cauchemar dans le service à la clientèle, à vendre des vélos, des chaussures, de la bière. Des souvenirs dans le Vieux-Québec et des jeans sur le boulevard Saint-Laurent, à Montréal.
Le client ayant fini par croire qu'il est effectivement roi et que son noble statut le dispense de toute délicatesse, il déshumanise couramment un personnel qui est ainsi réduit à une forme de servitude. M'étant fait braquer alors que je travaillais dans cette artère montréalaise, j'exagérerais à peine en disant que le voleur n'a pas été le plus désagréable des personnages que j'ai croisés au fil des ans. Il avait pris le temps d'essayer deux pantalons et avait au moins eu la décence d'être poli avant de me mettre son arme sous le nez.
Ce qui n'est pas le cas du type qui coupe la file d'attente à l'épicerie, de l'automobiliste qui refuse de vous laisser vous insérer dans le trafic et garde le regard braqué vers l'avant, sans parler de tous les anonymes qui infectent le Web avec leurs commentaires immondes, réclamant que la liberté de parole soit aussi celle d'injurier.
Pour ce qui est du client insolent, il bafoue les règles d'une essentielle politesse qui n'est pas qu'un lubrifiant social : c'est un ciment. C'est elle qui régule la société et rend les rapports avec les autres tolérables. Elle est aussi un indicateur de valeurs communes, nécessaires au vivre-ensemble. À commencer par une idée de respect et d'égalité entre les êtres.
Experte en la matière, Dominique Picard est professeure de psychologie sociale et auteure de deux ouvrages sur le sujet. Ayant passé en revue les observations des sociologues et psychanalystes et étudié l'histoire des traités de savoir-vivre à l'usage des différentes générations, elle expose que ces bonnes manières conspuées par les soixante-huitards - sous prétexte qu'il s'agissait d'un instrument d'exclusion sociale bourgeois - ne peuvent être écartées sans que cela provoque l'effondrement d'une certaine paix sociale.
J'oserais même avancer que c'est désormais l'impolitesse qui est le nouvel outil d'exclusion, à l'avantage du plus fort en gueule et du plus brutal. La courtoisie devient un indice de faiblesse qu'on évite de montrer.
En même temps, on connaît la règle : il faut être poli. Ce qui explique peut-être que c'est derrière le volant et dans l'anonymat de la foule ou du Web que foisonne le plus librement l'impolitesse. Ou alors dans le rapport de force client-vendeur. Là, on peut enfin être soi-même, sans le théâtre que nécessite la vie en société.
La recherche de vérité et d'authenticité que souhaitaient les détracteurs du savoir-vivre ne donne cependant pas le résultat escompté : nous rendre tous égaux. Comme de nombreux idéaux dévoyés par l'hyper-individualisme, le rejet des bonnes manières est devenu l'expression du culte de soi, de la volonté de chacun de « jouir sans entraves », sans égard aux autres.
Et voilà qu'on découvre avec horreur que nos cours d'école en subissent le contrecoup, que l'intimidation n'y est plus anecdotique, mais quotidienne. Comme si les enfants nous tendaient un miroir, nous montrant qu'on a beau leur répéter d'être polis, les paroles s'envolent. Mais le mauvais exemple reste.
Extrait de David Desjardins dans http://www.lactualite.com
Politesse...
Adjectif de même famille : « délicat » ; « courtois ».
Antonyme : « indélicat » ; « discourtois ».
Outils de la langue : activité 7⚓
Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 3
Le stylo n'a pas dit son dernier mot⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 19_CE1_stylo.pdf
Texte à lire
LE STYLO N'A PAS DIT SON DERNIER MOT
Vous avez sans doute, ces derniers jours, griffonné une liste de courses sur un bout de papier ou laissé un Post-it sur un bureau. Peut-être avez-vous écrit un mot dans le cahier de correspondance de votre enfant ou pris rapidement des notes pendant une réunion. Mais quand avez-vous rédigé pour la dernière fois un long texte à la main ? A quand remonte votre dernier courrier « à l'ancienne », réalisé avec un stylo, sur une feuille de papier ? Faites-vous partie de ces gens, qui, dans leur activité professionnelle, abandonnent peu à peu le crayon au profit des agréments du clavier ?
Nul ne peut encore mesurer avec précision le déclin de l'écriture manuscrite, mais une enquête britannique, effectuée en juin auprès de 2 000 personnes, laisse entrevoir la profondeur du phénomène. Selon ce sondage commandé par Docmail, un Britannique sur trois n'a pas écrit à la main depuis six mois – en moyenne, le dernier document tracé au stylo remonterait à quarante et un jours. Les gens écrivent sans doute plus qu'ils ne le pensent, mais une chose est sûre : les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de rédiger des textes avec une telle rapidité que, dans le monde du travail, elles supplantent peu à peu l'écriture manuscrite.
Les États-Unis en ont tiré les conséquences. Puisque les mails et les SMS ont remplacé les courriers, puisque les étudiants prennent désormais leurs notes sur ordinateur, puisque les employés effectuent leurs travaux sur écran, l'écriture dite « cursive », qui lie entre elles les lettres d'un même mot, ne fait plus partie des enseignements obligatoires du « Common Core Curriculum Standards », le socle commun à tous les États. Depuis 2013, les petits Américains sont obligés d'apprendre l'usage du clavier et l'écriture « script » (les caractères d'imprimerie), mais ils ne sont plus tenus de peiner sur les pleins et les déliés de l'écriture « attachée », encore moins sur ses capitales ornées de boucles.
INTENSES CONTROVERSES
Aux États-Unis, cette réforme a donné lieu à d'intenses controverses. Dans un éditorial publié le 4 septembre 2013, le Los Angeles Times s'est félicité de cette salutaire avancée. « Les États et les écoles ne devraient pas s'obstiner à apprendre aux enfants à écrire en attaché sur la foi d'une idée romantique selon laquelle c'est une tradition, un art ou une compétence fondamentale dont la disparition serait une tragédie culturelle. Évidemment, tout le monde doit être capable d'écrire sans ordinateur mais, d'une manière générale, l'écriture script est suffisante. (...) Écrire en caractères d'imprimerie est plus clair et plus lisible. Et, pour beaucoup, c'est également plus facile et quasiment aussi rapide. »
Certains États, comme l'Indiana, ont cependant décidé de maintenir l'apprentissage de l'écriture cursive à l'école. Si cet enseignement disparaît, affirment-ils, les jeunes Américains ne pourront plus lire les cartes d'anniversaire de leurs grands-parents, les annotations que les professeurs portent sur leurs copies, ou le texte original de la Constitution et de la Déclaration d'indépendance, qui ont été rédigées à la main. « Personnellement, je n'arrive plus à me rappeler la dernière fois que j'ai lu la Constitution », a rétorqué avec humour l'universitaire Steve Graham, professeur de sciences de l'éducation à Arizona State University.
LES OUTILS ET LES SUPPORTS DE L'ÉCRITURE N'ONT CESSÉ DE CHANGER
Cette petite révolution a beau déchaîner les passions, elle ne constitue pas tout à fait une première. Depuis l'invention de l'écriture en Mésopotamie, 4 000 ans avant notre ère, l'humanité a traversé bien des révolutions technologiques. Des tablettes sumériennes à l'alphabet phénicien du premier millénaire avant Jésus-Christ, de l'invention du papier, en Chine, au début de notre ère, à la naissance du codex – ce cahier de feuilles manuscrites qui deviendra le livre –, de l'invention de l'imprimerie au XVe siècle à l'apparition du stylo Bic dans les années 1960, les outils et les supports de l'écriture n'ont cessé de changer.
A première vue, la bataille entre le clavier et le stylo pourrait donc apparaître comme le énième soubresaut de la longue histoire de l'écriture – une simple affaire d'outil auquel l'homme finira, vaille que vaille, par s'adapter. Peu importe d'ailleurs la manière dont on écrit un texte, pense-t-on souvent, ce qui compte, c'est sa qualité. Qui se demande, à la lecture d'un document, s'il a été rédigé avec un stylo ou tapé sur un ordinateur ? Qui s'interroge, lorsqu'il découvre un écrit, sur le geste technique qui a permis d'en conserver la trace ?
DES SCHÉMAS COGNITIFS TRÈS DIFFÉRENTS
Les experts de l'écriture nous racontent pourtant une autre histoire : le stylo et le clavier font appel à des schémas cognitifs très différents. « L'écriture manuelle est un geste complexe qui mobilise à la fois des capacités sensorielles – je sens le stylo et la feuille –, motrices – j'utilise mes doigts – et cognitives – je dirige le mouvement par la pensée », souligne Edouard Gentaz, directeur de recherche au CNRS et professeur de psychologie du développement à l'université de Genève. « Les enfants mettent d'ailleurs plusieurs années à maîtriser cet exercice de motricité fine : il faut arriver à tenir fermement l'outil scripteur tout en le déplaçant pour laisser une trace différente pour chaque lettre. »
Avec le clavier, l'enfant ne travaille pas du tout de la même façon. Il ne s'agit plus de dessiner une lettre en faisant appel à sa mémoire visuelle et à son habilité manuelle, mais de repérer une touche et de la frapper. Le geste est facile – les enfants l'acquièrent d'ailleurs très rapidement – mais surtout, il est le même, quelle que soit la lettre : pour écrire un A ou un T, le mouvement de la main est identique. « C'est un changement important », résume le chef du service de psychiatrie pour adultes de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), Roland Jouvent, qui prépare un livre sur ce sujet. « L'écriture manuscrite est inscrite dans un mouvement singulier du corps, l'écriture au clavier ne l'est pas. »
(...)
Le passage du stylo au clavier est donc loin d'être une simple affaire d'outil. Modifie-t-il pour autant en profondeur notre rapport à l'écriture ou à la lecture ? En aucune manière, répondent les partisans du clavier. « Ce que nous demandons à l'écriture, c'est l'automaticité cognitive, la capacité de penser le plus rapidement possible, libéré des contraintes que nous impose l'outil qui nous permet de conserver une trace de nos pensées », estime l'essayiste américaine Anne Trubek dans un article. (...) « C'est cela que nous promet le clavier. Il nous permet d'aller plus vite – pas parce que nous voulons que tout aille plus vite, mais pour la raison inverse : nous voulons avoir plus de temps pour penser. » Comme tous les partisans de la suppression de l'apprentissage de l'écriture cursive aux États-Unis, Anne Trubek fait valoir les incontestables avantages du clavier – la rapidité de la frappe, la souplesse du copier-coller, l'utilité de la correction orthographique, la lisibilité des textes, la clarté de la présentation. « Le fait de taper, mes doigts dansant magiquement sur le clavier, libérés de tout effort conscient », me surprendra toujours, explique-t-elle. « La dactylographie est l'une des illustrations éclatantes du principe de l'automaticité cognitive, la vitesse d'exécution suivant le rythme de la vitesse de la cognition. »
« LE TRACE DES LETTRES A LA MAIN AMÉLIORE SENSIBLEMENT LA RECONNAISSANCE DES LETTRES »
Certains spécialistes des neurosciences sont cependant perplexes : ils estiment que l'abandon de l'écriture manuscrite aura des conséquences sur l'apprentissage de la lecture. « Le tracé des lettres à la main améliore sensiblement la reconnaissance des lettres », explique Edouard Gentaz. « Marieke Longchamp et Jean-Luc Velay, deux chercheurs du laboratoire de neurosciences cognitives du CNRS et de l'université Aix-Marseille, ont mené une étude auprès de 76 enfants âgés de 3 à 5 ans : le groupe qui avait appris à dessiner les lettres à la main les reconnaissait mieux que le groupe qui les avait apprises en tapant sur un clavier. Ils ont mené le même travail auprès d'adultes à qui on apprenait des caractères bengalis ou tamouls : ceux qui avaient appris à les tracer au stylo les mémorisaient mieux que ceux qui les avaient tapés au clavier. »
« MÉMOIRE DU CORPS »
Si le tracé manuel de la lettre améliore la connaissance de l'alphabet, c'est parce que nous avons une véritable « mémoire du corps » , explique Edouard Gentaz. « Après un accident vasculaire cérébral, certaines personnes ont du mal à lire. Pour qu'ils se remémorent l'alphabet, on leur fait dessiner des lettres avec le doigt – et souvent, ça marche, le geste réveille le souvenir ! »
Si l'apprentissage de l'écriture manuscrite semble jouer un rôle important dans la lecture, nul ne sait en revanche si l'outil modifie la qualité d'un texte. S'exprime-t-on plus librement, plus efficacement, plus clairement avec un stylo qu'avec un clavier ? Le cerveau fonctionne-t-il différemment en fonction des outils ? Certaines études semblent le laisser penser. Dans un article publié en avril dans la revue Psychological Science, deux chercheurs américains, Pam Mueller et Daniel Oppenheimer, affirment ainsi que la prise de notes au stylo permet de mieux s'approprier un cours que la prise de notes au clavier.
Menées auprès d'un peu plus de 300 étudiants de Princeton et de Californie, leurs études montrent que les élèves qui prennent des notes à la main répondent plus facilement aux questions complexes sur le cours que ceux qui ont utilisé un ordinateur. Selon les scientifiques, l'explication est simple : lors de la prise de notes, les adeptes du stylo reformulent les cours dans leurs écrits, ce qui les oblige à mener un premier travail de synthèse et de compréhension. Les utilisateurs du clavier ont tendance, au contraire, à prendre beaucoup de notes et à saisir des transcriptions littérales, ce qui les priverait de ce précieux travail de réflexion.
BEAUCOUP DE CHERCHEURS REFUSENT DE TIRER DES CONCLUSIONS
Beaucoup de chercheurs refusent cependant de tirer des conclusions de ces travaux : nul ne sait, par exemple, si les étudiants qui travaillaient sur ordinateur avaient la même aisance avec leur clavier que les étudiants avec leur main. Si ce n'était pas le cas, peut-être ont-ils choisi le verbatim parce qu'une partie de leur concentration était absorbée par la recherche des touches. « Il faut être prudent », précise Edouard Gentaz. « Cette expérience n'a pas été rééditée, et il se peut qu'il y ait des biais. A ma connaissance, il n'existe pas encore de travaux qui prouvent que l'utilisation du stylo ou du clavier modifie la manière dont on conçoit un texte ou dont on organise sa pensée ».
LA FRANCE A CHOISI D'INSISTER SUR L'ÉCRITURE « ATTACHÉE »
Dans le doute, la France a suivi un chemin inverse de celui emprunté par les États-Unis. Au début des années 2000, alors que les ordinateurs envahissaient les salles de classe américaines, le ministère de l'éducation nationale français demandait aux professeurs de commencer l'apprentissage de l'écriture cursive dès la fin de la maternelle. « On a longtemps méconnu la portée et l'importance de l'écriture manuscrite, qui était considérée comme une activité un peu routinière », se souvient Viviane Bouysse, inspectrice générale de l'éducation nationale. « Au début des années 2000, grâce aux travaux neuroscientifiques, on a compris en quoi son apprentissage constitue en fait un moment-clé de l'éveil cognitif. »
Plutôt que de s'orienter vers le script et le clavier, la France a choisi d'insister sur l'écriture « attachée ». « En liant les lettres les unes aux autres, l'enfant acquiert l'image du bloc que représente le mot, et donc, son orthographe », poursuit Viviane Bouysse. « C'est important dans un pays où l'orthographe est si complexe ! En revanche, les modèles d'écriture scolaire de 2013 ont simplifié les majuscules ornées. Elles étaient si difficiles à dessiner que leur apprentissage était un peu tardif – en général, au CE1. C'est un tort. Il faut les apprendre tôt, parce qu'elles ont une fonction importante : elles indiquent un nom propre ou le début d'une phrase. Aujourd'hui, les boucles sont moins ornées mais les enfants comprennent plus vite le sens de la majuscule. »
« IL Y A UNE DANSE DE L'ÉCRITURE »
En France, le maintien de l'apprentissage du cursif à l'école semble donc acquis. Cette politique ne suffit pas à rassurer les partisans de l'écriture manuscrite, qui regrettent déjà la puissance expressive des pleins et des déliés. « Dans les boucles du A majuscule orné, on ne se contente pas d'écrire une lettre : on dessine, on apprend l'harmonie, l'équilibre, les rondeurs », estime le psychiatre Roland Jouvent. « Il y a une danse de l'écriture, une mélodie du message, qui ajoute de l'émotion dans les textes. C'est d'ailleurs pour retrouver cette poésie que l'on a inventé, dans les SMS, les émoticônes, ces petits signes graphiques qui nous indiquent un sourire ou une déception. »
L'écriture, de fait, a toujours été considérée comme un signe d'expression de la personnalité : dans ses livres, l'historien Philippe Artières a exploré la manière dont les médecins et les policiers, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, décryptaient, dans le dessin des lettres, les signes de déviance des fous ou des délinquants. « Avec l'écriture manuscrite, on se rapproche de l'intimité de celui qui a tracé les mots », poursuit Roland Jouvent. « C'est pour cela qu'on est plus ému par un manuscrit de Verlaine que par le même poème, en caractères d'imprimerie, dans un livre. Chaque écriture est différente, elle a une gestuelle émotionnelle, un charme qui lui est propre. » D'où le rapport narcissique que nous entretenons souvent avec notre propre calligraphie.
LES ARTS GRAPHIQUES ET LA CALLIGRAPHIE SE PORTENT TRÈS BIEN
Malgré l'omniprésence des ordinateurs, Edouard Gentaz ne croit cependant pas à la disparition de l'écriture manuscrite. « Les écrans tactiles et les stylets permettront au geste de revenir. Le clavier n'est peut-être qu'un moment de passage. » « L'écriture manuelle reste très présente dans les pratiques quotidiennes », renchérit Claire Bustarret. « Les gens écrivent à la main plus souvent qu'ils ne le croient, ne serait-ce que pour remplir un formulaire ou rédiger une étiquette pour un pot de confiture. L'écriture est d'ailleurs bien vivante dans notre environnement, du graphisme publicitaire ou signalétique aux graffitis de la rue ou divers écrits de contestation. » Les arts graphiques et la calligraphie se portent d'ailleurs très bien. Peut-être parce qu'ils compensent, à leur manière, la sécheresse du clavier.
Anne Chemin - Le Monde - 15.11.2014
Compréhension écrite : activité 1⚓
Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Compréhension écrite : activité 2⚓
Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Exercice 5
Exercice 6
Exercice 7
Compréhension écrite : activité 3⚓
Compréhension écrite : activité 4⚓
Méthode :
Relisez les parties 8 à 10 de l'article LE STYLO N'A PAS DIT SON DERNIER MOT[*] avant de répondre aux questions
Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Exercice 5
Exercice 6
Exercice 7
Compréhension écrite : activité 5⚓
Question⚓
A votre avis, quelle est la position de l'auteur de cet article concernant l'écriture cursive ? Justifiez votre point de vue en quelques lignes en prenant appui sur des éléments du texte.
Avant de répondre, vous pouvez relire le texte en cliquant sur LE STYLO N'A PAS DIT SON DERNIER MOT[*]
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la solution !
Solution⚓
Au regard des éléments textuels ci-dessous, l'auteur semble plutôt favorable à l'écriture cursive.
Le titre de l'article "le stylo n'a pas dit son dernier mot" peut apparaître comme une prise de position qui indique que le "stylo n'est pas encore mort". Après les arguments scientifiques sur l'intérêt de l'apprentissage de l'écriture cursive, en particulier pour la langue française, les deux dernières parties, qui concluent l'article, mettent en avant le charme de l'écriture manuelle : il y a "une danse des mots" dans l'écriture qui est une "expression de la personnalité". D'ailleurs, "les arts graphiques et la calligraphie se portent très bien" et compensent la "sécheresse" du clavier.
Pour aller plus loin... Le saviez-vous ?⚓
Complément :
Comment apprend-on à écrire à l'école au Sénégal ?
Lisez cet extrait du CEB révisé (2015) pour l'école élémentaire.
Extrait du CEB au CI
La complexité de l'activité d'écriture réside dans le fait qu'elle met en jeu la main et l'œil, tout en s'appuyant sur le contrôle du mouvement, la précision du geste, l'orientation dans l'espace et le sens du rythme. L'apprenant doit maîtriser la surface de travail et adapter son geste à l'outil utilisé.
Du palier 1 à 3 au CI, l'écriture scripte est privilégiée.
A partir du palier 4 du CI, l'écriture cursive est introduite, en favorisant la forme des tracés :
les familles des boucles vers le haut : b,e,h,k,l
les coupes : u,t,j
les ronds : o,c,a,d,q
les ponts : m,n,p
les boucles vers le bas : j,y,g
les boucles vers le haut et le bas : f
les boucles combinées : s,r,z,x
les autres formes : v,w
A partir du palier 4, l'écriture des lettres ne suit donc pas exclusivement la progression des sons.
Outils de la langue : activité 6⚓
Outils de la langue : activité 7⚓
La vie scolaire⚓
Cette ressource est aussi téléchargeable pour impression au format pdf 20_CE1_vie_scolaire.pdf
Méthode : Introduction
Dans cette activité, vous allez étudier successivement 3 documents.
Puis, après avoir répondu aux questions relatives à chaque document (deux textes et un dessin), vous ferez la synthèse des documents proposés en mettant en évidence :
les caractéristiques de la situation dans les établissements scolaires
les causes de cette situation
ses conséquences
Texte à lire n°1⚓
VOUS ET MOI - EUX
Il y a quelques années, les salles de classe résonnaient des lamentations des plus anciens et le traditionnel « je vous dis que le niveau baisse » faisaient sourire les jeunes, peu sensibles à la nostalgie d'un âge d'or qu'ils n'avaient pas connu. Il leur suffisait de penser aux jeunes profs, qu'il fallait un peu le contenu de l'enseignement et les méthodes (ah ! les premiers succès des méthodes audio-orales...) pour transformer les rapports avec les élèves et faire oublier ce terme de « niveau » qui sentait le graphique et la statistique primaire.
Curieusement, depuis peu, les rôles se sont inversés. Les collègues proches de la retraite semblent figés dans un mutisme résigné ; apparemment ils n'attendent plus que leur libération. Par contre, dès la sonnerie de l'interclasse, on voit s'affaler des profs encore jeunes et réputés dynamiques, qui se prennent la tête dans les mains : « Je ne sais pas ce qui se passe, je n'arrive plus à me faire entendre. Cette année, les sixièmes sont pires que l'an dernier. J'ai tout essayé, je suis tout le temps dans uns un brouillard épuisant. » « Ah ! Toi aussi », renchérit le voisin, et rapidement on en passe aux considérations générales. Le fait est que depuis deux ou trois ans, si l'on doit dater ce phénomène, l'enseignant a plus affaire non plus à des classes mais à des sommes d'individus.
Vous me direz : où est la différence ? Elle est de taille. Vous interrogez un élève : au même moment vous déclenchez un tollé général. « Moi aussi, je le sais. », « Interrogez-moi Madame ! », « Pourquoi c'est toujours les mêmes ? » , « Moi ! » , « Moi on ne m'interroge jamais ! ». Au début vous pensez que vous favorisez certains, sans vous en rendre compte. Vous vérifiez. Non, pas du tout. Résultat, vous ne pouvez plus interroger un élève sans que d'autres, au hasard, répondent à sa place. Il n'est pas question, pour eux, d'attendre un tour de rôle.
Mais il y a d'autres signes. La classe c'était un bloc de solidarité contre l'autorité que représentait, bon an, mal an, le professeur. Bien sûr, il y avait toujours un mouchard, mais il était vite mis au pas. Vous oubliez un exercice, vous ne donnez pas suite à une menace, personne ne se chargeait de vous remettre dans la juste répression. Aujourd'hui, à peine entrés dans la classe, ils commencent les dénonciations : « Pierre a pas fait son devoir Madame », « De doute façon, toi tu as copié sur Nathalie » rétorque l'autre. On vient aussi vous voir à la fin du cours : « Pourquoi vous lui donnez pas une colle à untel, Madame ? Vous savez, les autres, ils lui en donnent. »
Inutile de préciser que, dans ces conditions, le travail de groupe est impossible. Il tourne vite au pugilat.
Mettre le phénomène sur le compte de l' « âge ingrat » où « l'adolenfant » hésite entre deux comportements contradictoires, ou bien l'impression de gare de triage que donnent de plus en plus les collèges, ne suffit pas. Pourquoi ce manque de complicité (qui ne permet même plus les bons vieux chahuts, soit dit en passant), à un âge ou les bandes, les groupes, les clans avaient une telle importance, il n'y a pas longtemps ?
Je crois qu'une fois de plus, il faut accuser la télé. Non pas tant pour ce qu'elle diffuse, que la place tient dans la vie du groupe familial.
Il y a eu le temps des repas autour de la soupière ; on attendait que l'un ait fini pour placer la sienne, on apprenait à parler à plusieurs. Puis est venu le temps de la sacro-sainte télé qu'on mettait sur la table et qu'on écoutait sans piper, entre le « chcht » et les « tais-toi, j'entends rien ». Maintenant la télé, c'est un peu la vieille radoteuse qu'on écoute à peine ce qu'elle dit ; elle est allumée, bien en vue mais on force la voix pour parler d'autre chose : les enfants passent devant l'écran et se chamaillent sans provoquer de fortes réactions. Le prof, dans le meilleur des cas, c'est la speakerine. Les enfants attendent d'elle qu'elle ait un rapport privilégié avec chacun d'eux, individuellement. Ils ne « sentent » pas les autres autour d'eux, comme des spectateurs qui regardent le même film. Quand ils n'ont plus envie de la regarder ou de l'écouter par contre ils peuvent parler à haute voix, taquiner le voisin, le pourchasser dans la classe : pour eux, elle n'existe plus. Je dirais même qu'ils s'étonnent qu'elle se fâche. Elle n'a qu'à parler aux autres. Ce qui rend les profs perplexes c'est qu'il ne s'agit ni de mauvaise volonté, ni de non-respect, ni de provocation. Cela, ils sauraient y remédier. Il s'agit des premiers rudiments de la vie en société. Or, il est clair que, pour un enfant de douze ans, le fait que dix personnes parlent à la fois par exemple, est une situation absolument normale où il baigne tous les jours depuis sa plus tendre enfance. Reste que le prof, lui, a du mal à assurer plusieurs chaînes à la fois.
C. Rollet, Le Monde du dimanche, 9 décembre 1979
Compréhension du texte n°1-a⚓
Exercice 2
Exercice 3
Exercice 4
Compréhension du texte n°1-b⚓
Consigne
Question⚓
Citez deux conséquences de ce mal vivre chez les élèves.
Si nécessaire relisez le texte VOUS ET MOI - EUX[*] avant de répondre.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la solution.
Outils de la langue-a⚓
Outils de la langue-b⚓
Texte à lire n° 2⚓
Le collège, lieu de vie et de rencontres
Un établissement scolaire est un milieu conçu et organisé par les adultes pour transmettre à leurs successeurs les connaissances qu'ils estiment indispensables. Mais, pour les jeunes qui le fréquentent, c'est aussi autre chose : c'est un lieu de vie et de rencontres. En effet, c'est l'endroit où ils passent le plus clair de leur temps. Or la vie d'un jeune ne se réduit pas à l'acte d'apprendre. Dans bien des cas, c'est même le cadet de ses soucis. Il y a, de plus, tant de choses à découvrir – ou à craindre - à cet âge ! Or cette dimension – essentielle - de la vie des adolescents n'est nullement prise en compte par le collège. L'éducation ne s'occupe pas de « cela ». C'est pourtant « cela » - ce bouillonnement affectif, ce choc des personnalités en gestation – qui exercice sur l'institution scolaire une pression qui parfois la fait trembler.
Une étude réalisée par le Centre de sociologie des organisations sur douze collège, montre que, parvenus en troisième, les élèves ont une très forte réaction de rejet à l'égard de l'établissement : ils ne s'y sentent plus bien, en critiquent la discipline, estiment qu'il n'y a pas assez d'activités extra-scolaires et qu'on ne tient pas assez compte de leur avis. Ils sont aussi très sévères à l'égard des enseignants alors qu'en sixième les jugements étaient plutôt positifs. A l'inverse, en de la sixième à la troisième, ils estiment que l'entente entre les élèves s'est améliorée et que la solidarité a progressé.
Ainsi, du point de vue des élèves, ce qui est positif dans le bilan des quatre années, c'est l'expérience des relations nouvelles entre camarades, beaucoup plus que les rapports avec les institutions (que ce soit le collège ou les professeurs). Alors que le milieu éducatif où ils sont immergés est exclusivement mobilisé pour la formation intellectuelle, ce qui, pour eux, a compté, c'est l'apprentissage de la vie en commun, l'expérience collective.
F. Gaussen, Le Monde, 22 novembre, 1981.
Compréhension du texte n°2-a⚓
Exercice 1
Exercice 2
Exercice 3
Compréhension du texte n°2-b⚓
Exercice 1
Question⚓
Citez 3 reproches que les élèves formulent à l'endroit du collège.
Relisez le texte Le collège, lieu de vie et de rencontres[*] avant de répondre à la question.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter vos réponses avant d'afficher la solution !
Exercice 2
Question⚓
Que traduit le rejet de l'institution scolaire par les élèves ?
Relisez le texte Le collège, lieu de vie et de rencontres[*] avant de répondre à la question.
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour noter vos réponses avant d'afficher la solution !
Outils de la langue-a⚓
Outils de la langue-b⚓
Document à lire n° 3⚓
Compréhension du document n°3-a⚓
Compréhension du document n°3-b⚓
Compréhension du document n°3-c⚓
Question⚓
Comment perçoit-on les rapports entre l'adolescent et les parents au regard de l'attitude des parents ? Est-ce le schéma classique de l'autorité parentale ?
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la solution.
Outils de la langue⚓
Exercice 1
Exercice 2
Question⚓
Que suggèrent les signes de ponctuation qui terminent le discours du jeune homme ?
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre réponse avant d'afficher la solution.
Synthèse⚓
Question⚓
Après avoir répondu aux questions relatives à chaque support (deux textes et un dessin), faîtes la synthèse des documents proposés en mettant en évidence :
les caractéristiques de la situation dans les établissements scolaires
les causes de cette situation
ses conséquences
Utilisez la zone de saisie ci-dessous pour rédiger votre synthèse avant d'afficher la Solution !
Solution⚓
Autrefois, les professeurs les plus anciens se plaignaient de la « baisse du niveau ». Leurs collègues plus jeunes ne partageaient pas ce pessimisme, ayant foi en une rénovation des méthodes d'enseignement. Aujourd'hui, ce sont les jeunes enseignants qui se plaignent ; les anciens se taisent. Tous expriment, à leur façon, un constat d'échec. Ils n'ont plus le sentiment d'avoir affaire à une classe mais à une juxtaposition d'individus. Ils le perçoivent à travers les comportements des élèves en classe : ce sont des réactions disparates, contradictoires, multiples et qui manquent de solidarité. Le résultat est un désordre permanent qui provoque le chahut.
Cette situation a plusieurs causes. D'abord les enseignants ne sont pas préparés à cette nouvelle situation. Leur inexpérience ne leur permet pas souvent de comprendre leurs élèves. Ainsi, ils tiennent pour insolence une attitude ou posture courante chez les jeunes. Autre cause de l'échec : adultes et jeunes ne donnent pas au collège la même finalité. Les adultes le conçoivent comme un lieu où se transmet le savoir, les jeunes comme un espace où se font les relations humaines et les découvertes. Ce malentendu culmine en troisième. Enfin, la télévision est à incriminer. Les élèves reproduisent en classe ce qui se passe autour de la table familiale : le professeur est la télévision et l'on parle en même temps qu'elle. Ou bien l'on attend que le professeur ait avec chaque élève la relation privilégiée que tout téléspectateur croit avoir avec la speakerine. Il n'y a là nulle intention de provoquer : c'est la marque d'un défaut de socialisation provoqué par l'influence négative de la télévision.
Cette situation n'est pas sans conséquences. La réaction des élèves traduit le rejet de l'établissement scolaire. D'autre part, ils ne se sentent plus bien dans leurs collèges : ils blâment leurs enseignants et ne reconnaissent à la vie scolaire qu'un aspect positif : l'entente qu'il y a entre eux. Ils estiment ainsi avoir fait l'apprentissage de la vie collective, au cours de leur scolarité et non l'apprentissage intellectuel qu'on leur avait destiné.
Rédacteurs⚓
Mamadou COULIBALY – Personne ressource Ousmane DIAGNE – INEADE Mamadou Baïdy DIENG – Alliance française Kaolack Amadou Moustapha Thialaw DIOP – Personne ressource Abdoulaye DIOUF – UCAD Mor Anta KANDJI – CRFPE Kaolack | Moussa KANTE – Personne ressource Muriel NICOT-GUILLOREL – CT MEN Abdoulaye Ibnou SECK – DEMSG Amadou Beye SY –DEE Amadou Bamba THIOBANE – Personne ressource |






